17/08/2010
BULLETIN CELINIEN
Bulletin célinien N° 321
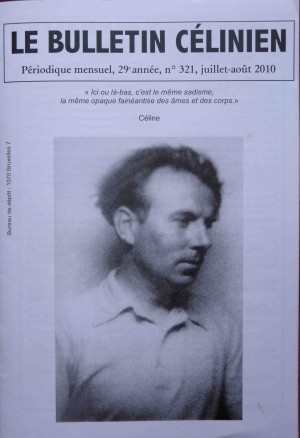
« Cet homme était pure sensibilité », c’est ce qu’écrit Jacques TREMOLET de VILLERS dans un article commis à la faveur de la parution d’une partie de la correspondance célinienne dans la Pléiade. Cet article repris dans ce 321ème bulletin, évoque la tendresse que portait Céline aux enfants, aux déshérités, aux « pauvres de partout », aux animaux, à tous les malheureux de la terre. Son expérience précoce de la guerre, son exercice de la médecine, la traversée de l’Allemagne sous les bombes, son exil au Danemark traqué par les comités d’épuration et les conditions de détention dont il eut à souffrir, l’avaient sapé au point qu’il ne pouvait supporter la souffrance chez un autre être. Qu’il ait eu la dent longue pour l’espèce humaine en général -et l’auteur de l’article le rappelle- nul ne le contestera ; c’est qu’il connaissait trop bien la nature des hommes pour ne pas avoir à s’en méfier ! Ce qui ne l’empêcha point d’en secourir plus d’un en particulier, qu’il aida du mieux qu’il pu. L’auteur nous rappelle cette phrase que Simone Weil, dit-il, avait recopiée dans son cahier où elle écrivait les mots qui « sculptent le silence intérieur » :
« La vérité est une agonie qui n’en finit pas. La vérité de ce monde c’est la mort. »
Et c’est toute l’œuvre célinienne qui tourne, peu ou proue autour de la mort, parce que cette œuvre est née de la première guerre mondiale, catastrophe universelle, dont l’auteur du voyage est sorti définitivement désillusionné.

L’article de J. Trémolet de Villers s’achève sur l’extrait d’une lettre à Marie Canavaggia datée du 19 novembre 1945 qui vaut d’être cité parce qu’il ramène l’homme à son point de départ, dans l’assurance du gîte et du couvert :
« Lorsque la folie des jours et des années s’est éteinte que notre loque n’est plus qu’un débris de fatigues, c’est la moindre des cruautés un petit brouet et un toit pour finir cette aventure atroce. Mais si le brouet et le toit font défaut alors c’est un calvaire sans nom. Regardez les animaux nos maîtres en destinée – comme ils tiennent si sagement si pathétiquement à leur vieux tapis – Braves êtres - ! Il faut avoir été chassé sans merci de tout et partout pour devenir bien simple, bien simple… pour penser comme un chien - »
Le bloc-notes de Marc LAUDELOUT évoque la chape de plomb qui pèse –et n’a pas fini de peser- à l’évocation du seul nom de Céline ailleurs que dans la stricte sphère littéraire. Pour preuve, la réaction d’une conseillère municipale à l’accueil proposé par la première élue de Dinard au colloque de la Société des Etudes céliniennes. On voudrait dire à cette dame Craveia Schütz, que les « bouffées humanistes » qu’elle déplore ne pas avoir trouvées dans l’œuvre célinienne (l’a-t-elle bien lue ?) sont à laisser au compte de ceux qui se font photographier en porte-faix à l’instar de certain ministre ; les officines bien pensantes du politiquement correct connaissent le refrain… Non, Céline ne voyait pas « l’humanité » acéphale ; c’est « l’homme », qu’il voyait sur son chemin, l’homme tout seul, l’homme tout court, et souffrant de surcroît, qu’il secourait autant qu’il le pouvait, n’en déplaise à madame la conseillère. C’est une chose de dénoncer le mal, ç’en est une autre que de tenter d’y porter remède ; il existe une marge non négligeable des mots aux actes, jugeons sur ces derniers pour avoir l’assurance de ne pas nous tromper. Et saluons au passage l’initiative de Madame Mallet, maire de Dinard, dont le bulletin reproduit la lettre. On pourra regretter au passage qu’elle se soit crue obligée de se dédouaner quant aux écrits qui sentent le soufre. Quand on aime Céline, on le prend en bloc, tout entier et on fait la part des choses : il y a des latitudes où le style l’emporte sur les idées. Et d’ailleurs, lui-même ne disait rien d’autre, qui ne s’est jamais renié ; ce que rappelle Marc Laudelout en note : « Je ne renie rien du tout… je ne change pas d’opinion du tout… je mets simplement un petit doute, mais il faudrait qu’on me prouve que je me suis trompé, et pas moi que j’ai raison. »

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas demain qu’une quelconque rue du plus reculé des chefs- lieux de la plus lointaine province portera le nom de Céline ! Ou alors, comme aurait dit ce dernier, il sait pas, l’innocent téméraire de cette initiative, quel genre de valse on lui ferait danser !
Outre une note de Laurence CHARLIER nous informant de l’actualité célinienne, on trouvera dans ce 321ème numéro la préface que Jacqueline MORAND-DEVILLER a donnée à la réédition de sa thèse « Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline », parue en 1965 mais depuis longtemps épuisée. Cette nouvelle publication de 304p., due à l’initiative d’Emile Brami, est disponible aux Ed. Ecriture, coll. « Céline & Cie ».
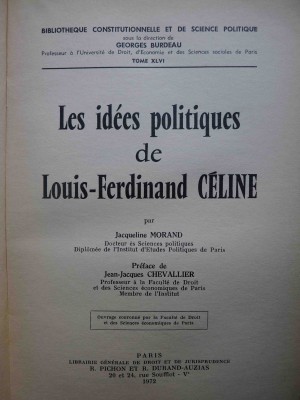
Le Bulletin signale également la parution d’un « Dictionnaire du pamphlet » dû à Frédéric SAENEN et disponible dans la coll. « Illico » aux Ed. Infolio à Genève.
Enfin, l’éditorialiste propose une évocation de Maurice Bardèche enrichie d’un témoignage de Pierre MONNIER qui rappelle combien les anciens élèves de Bardèche tenaient l’érudition, le courage et l’humour de ce dernier en haute estime.
Pour conclure, Frédérique LEICHTER-FLACK est allée voir ce qui se cachait derrière l’allusion de Bardamu, desespéré par la mort de Bébert, sur « une page d’une lettre qu’il écrivait à sa femme le Montaigne, justement pour l’occasion d’un fils à eux qui venait de mourir ». Elle donne en note cette lettre, écrite par Montaigne de Paris, le 10 septembre 1570. L’auteur de l’article a bien vu que ce que Bardamu raillait chez Montaigne, « ce n’était pas la dérision en face de la mort d’un enfant, d’un effort littéraire de consolation, mais le scandale même de la tentative. », parce qu’il y a des chagrins inconsolables que le temps lui même ne peut pas effacer, pas davantage que les mots, qu’ils soit dits, ou écrits. Céline, sur le chapitre, savait à quoi s’en tenir…
15:13 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, laudelout, trémolet de villers, dinard, montaigne, guerre
30/06/2010
BULLETIN CELINIEN
Bulletin célinien n° 320

Ce numéro accorde une place importante à la danse. On sait en effet tout l’intérêt que portait Céline à cet art et l’attrait qu’exerçait sur lui les danseuses : une attirance quasi biologique.
On y remarque l’article d’Henri GODARD : « Céline et la danse » ; il rapporte cet extrait de Bagatelle qui en dit long sur la passion célinienne pour les jambes des danseuses : « Dans une jambe de danseuse le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits !... jamais écrits !... Le plus nuancé poème du monde !... émouvant ! (…) Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne, (…) aux écoutes du plus grand secret, c’est Dieu ! C’est Dieu lui-même ! Tout simplement ! (…) La vie les saisit, pures… les emporte… au moindre élan, je veux aller me perdre avec elles… toute la vie… frémissante, onduleuse… ».

N’était-ce point lui qui disait quelque part il me semble : « La véritable aristocratie humaine ce sont les jambes qui la confèrent, pas d’erreur ! »
Et Henri Godard a raison de noter ce que Céline admire particulièrement chez la danseuse : « Une lutte de chaque jour contre les effets que le temps fait subir au corps humain, en le soumettant toujours plus à la pesanteur et en ne lui faisant plus accomplir que des mouvements de moins en moins harmonieux… » et plus loin : « La danseuse est l’être humain qui mène avec le plus d’évidence contre cette mort avant la mort une action perdue d’avance mais glorieuse. »
Aussi n’est-ce point hasardeux qu’il ait écrit des « ballets » auxquels il tenait beaucoup, comme le rappelle Marc LAUDELOUT en rapportant ces mots d’un entretien de Céline avec Georges Conchon en 1958: « Je suis particulièrement fier de mes ballets. Autant mes livres, mon Dieu, je les trouve pas mal, mais les ballets, je les trouve très bien. »
Et curieusement, c’est dans Bagatelles que trois arguments de ballets trouveront leur place, comme s’il fallait « changer de piste », tourner le disque, apporter de la poésie dans un monde de brutes ; façon peut-être à l’auteur de se dédouaner, de montrer sa vraie nature de suggérer de quel côté il se trouve. C’est la question qu’on peut se poser et, à sa manière, l’éditorialiste ne manque pas de la soulever.
Il aura fallu attendre 1959 pour que Gallimard publie en tirage limité les « Ballets sans musique, sans personne, sans rien. » Illustrés par Eliane Bonabel, ils regroupent « La Naissance d’une fée », « Voyou Paul. Brave Virginie », « Van Bagaden », « Foudres et flèches » et « Scandale aux Abysses ». Robert POULET en rendit compte dans « Rivarol » du 30 juillet 1959. La lecture qu’il en fit est rapportée dans ce présent bulletin.
Outre deux pages réservées au courrier des lecteurs, on remarquera dans cette trois-cent vingtième livraison deux inédits rapportés par Marc LAUDELOUT : le premier concerne l’autodafé qu’aurait fait Allemagne hitlérienne du Voyage traduit en 1933 par Isak Grünberg ; il l’explique dans un article intitulé « Voyage au bout de la nuit brûlé par le IIIe Reich ? ». Le second, relate la participation de Céline le 5 mai 1938 à l’occasion de son séjour à Montréal, à l’assemblée du mouvement d’Adrien Arcand (1869-1967), le Parti National Social Chrétien. On le voit d’ailleurs, en première de couverture de ce bulletin, au milieu d’un groupe de fidèles. Cet article fort bien documenté et ses nombreuses notes très intéressantes montrent le soucis qu’avait Céline de préparer l’avenir, lui qui sentait monter la guerre comme le lait posé sur le feu : « Les partis de gauche qui mènent la France la poussent vers la guerre. (…) C’est déguelasse cette affaire. Encore la guerre. Deux fois en vingt ans, je le sais moi, ce que c’est, j’y suis allé, je suis mutilé. » Henri Béraud de son côté ne disait pas autre chose dans ses pamphlets…
C’est donc dans ce contexte surchauffé que l’auteur de Bagatelles songeait à l’exil outre atlantique : « Un seul espoir : le Canada. ». Sans doute, pour sa sécurité, eut-il mieux valu qu’il s’y rendît alors…

12:58 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2)
27/06/2010
LIEUX DU CRIME

L’assassin est un peintre au couteau qui dispose les objets de son crime comme l’artiste le fait d’une nature morte sur sa toile. Tout est arrangé à dessein de façon à « séduire » c’est-à-dire à impressionner le spectateur.
Le procédé est toujours le même : le peintre, ou le meurtrier professionnel, sélectionne ce qui en premier frappera l’observateur ; il calcule, analyse et s’applique à l’ouvrage du mieux qu’il peut. La pratique aidant, il le fait machinalement. Ayant en quelque sorte obtenu son brevet de maîtrise, il s’attache à transmettre son art ou à garder jalousement le secret de ses compositions. Le meurtrier occasionnel, lui, emporté par ses humeurs, n’obéissant qu’à l’aveuglement de sa passion, reste un amateur et gâche la toile.
On ne saura jamais quels soins apporta Chardin à ses natures mortes, mais ce que remarquèrent les artistes qui traitèrent de semblables sujets, c’est que toujours, « quelque chose » dépassait du bord du support de la composition : une feuille de vigne, un poireau, la patte d’un lièvre ou la pince d’un homard, mais plus généralement, le manche d’un couteau…

Le procédé ne date pas d’hier, mais sans doute de l’invention de la perspective ; les maîtres flamands en ont usé dès l’instant où ils ont compris quel avantage il accordait à la lecture de l’oeuvre en soulignant la profondeur de champs et la valeur du plan de la scène.
« Mon grand-père m’attendait dans son fauteuil de velours d’Utrecht. Je m’asseyais du côté de sa bonne oreille, car, depuis l’enfance, il était sourd de l’oreille droite, et, sous mes questions, sa langue n’était pas longue à se délier. Je réclamais le plus souvent, tant l’attrait m’en semblait inépuisable, l’histoire de l’Assassinat du petit garçon.
Il s’agissait d’un enfant de cinq ans qu’à l’époque des vacances de 1845, ses parents avaient abandonné dans leur maison de campagne sise à dix kilomètres d’Aubusson, à la garde d’une vieille femme de confiance. Tous les deux –le petit maître et la gouvernante- occupaient le même lit. Par une nuit d’étoiles, quelqu’un était venu, avait défoncé la fenêtre et, bondissant dans la pièce, un marteau de maçon à la main, s’était livré à une effroyable tuerie…
Le soir, quand je me retrouvais dans mon petit lit et que mes parents, après avoir emporté la lumière, me laissaient à mon sommeil ou à mes pensées, je frissonnais de tous mes membres. Le vent sous le rideau de la cheminée, un craquement dans les boiseries, un bruit de pas, le grincement d’une girouette, il n’en fallait pas davantage pour que mon cœur battit à coups précipités. Mais si je parvenais quelquefois à commander à mes angoisses, que devenais-je, grand Dieu ! quand le rêve m’emportait au pays de l’épouvante ? Brusquement, je me trouvais seul dans la maison du crime, en pleine nuit et loin de tout secours. Et, pendant que, les pieds cloués au sol, je cherchais en vain à crier ou à m’enfuir, l’assassin s’avançait vers moi en levant son marteau… »
Ainsi s’exprime Pierre Bouchardon dans ses « Souvenirs » qui furent édités en 1953.
Les œuvres de cet ancien magistrat, né à Guéret le 9 avril 1870, connurent un succès populaire par le fait qu’elles rapportaient, non seulement les procès des grandes affaires criminelles du temps, mais aussi des meurtres plus anciens inscrits au registre des classiques en la matière.
La plupart de ces récits, publiés par Albin Michel, sont encore assez faciles à trouver chez les bouquinistes ou sur le net, avec un peu de patience.
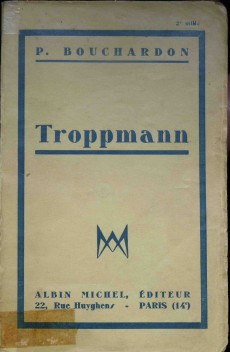
J’ai découvert cet auteur en achetant son « Troppmann » à un bouquiniste du Quai de la Mégisserie en 1970. J’ignorais tout de ce crime à faire « dresser les cheveux sur la tête ». Il eut lieu en 1869 en bordure du chemin Vert, dans la plaine de Pantin… Bouchardon le relate tel quel, dans toute son horreur. Ce magistrat, qui fut successivement juge, procureur de la République, chef du bureau des Affaires criminelles au Ministère de la Justice, président de la Cour d’appel de Paris et conseiller à la Cour de cassation, n’y va pas par quatre chemins et son art de narrateur, tout empreint de la faconde des tribunaux, nous transporte comme si nous assistions au procès, dans la salle d’audience…
Il nous emmène de la même manière sur les lieux du crime et nous fait partager, les yeux grand ouverts, ce que découvrirent les premiers témoins.
Sans doute l’ assassinat du petit garçon eut-il sa part dans la vocation de Pierre Bouchardon ; il le confesse d’ailleurs lui-même dans ses « Souvenirs » : « L’affaire m’obséda à ce point qu’elle ne fut pas étrangère, je le peux croire, à ma décision d’entrer dans la magistrature. » Et, comme il était doué pour écrire, il mit ses dons de narrateur au service de sa plume et nous laissa plus de trente récits, plus terribles les uns que les autres, dont on trouvera la liste en fin de note.
Tels nous surprendront à les relire « Le Crime de Vouziers », « L’Enfant de la Villette », « Le Puits du Presbytère d’Entrammes » ou « L’Affaire Pranzini ». Quant à l’auberge de Peyrebeille, dite « l’Auberge Rouge », sise sur la grand route du Puy à Aubenas, sans doute ne saura-t-on jamais exactement ce qu’il en fut, même si l’on se plaît à montrer au visiteur le four, la « poutre tragique », les chambres maudites… Ce qui est sûr c’est que tombèrent au milieu de la cour sous le couperet les deux têtes des époux Martin et celle de leur domestique Rochette. Une pierre dressée en marque l’emplacement exact.
Je n’ai point, pour ma part, embrassé la carrière de magistrat bien que j’ai été frappé et au même âge, tout autant qu’a pu l’être Pierre Bouchardon, par le récit que me fit ma grand-mère d’un crime abominable ayant eu lieu non loin de la propriété que nous occupions alors à Limoges, dans le quartier du quai Militaire. Souvent, je passais près de la maison du drame, aujourd’hui disparue… Elle occupait, au débouché du tunnel du chemin de fer au lieu dit le Puy-Imbert, l’angle d’une rue ; une grande maison carrée en face d’un lavoir, avec un jardin attenant livré aux broussailles… Et toutes les fois je me disais : « C’est là ! ».
Oui, c’était là qu’un jour de 1889, dans la nuit du 9 au 10 avril, une pauvresse, la femme Souhin, chiffonnière de son état, avait étranglé ses quatre petits dont les âges s’échelonnaient entre onze ans pour l’aîné des garçons et quelque mois pour la dernière-née. Ce que trouva à dire la criminelle qui ne pu, en dépit de ses tentatives parvenir à mettre un terme à ses jours, c’est qu’elle avait été contrainte de tuer ses enfants ne pouvant les nourrir, poussée à l’extrême pauvreté accrue par l’arrestation de son mari, auteur de quelque larcin. C’était un crime de la misère qu’avaient caché ces murs gris et austères ; fallait-il ajouter à l’horreur de ce quintuple infanticide le fait que leur mère, après avoir étranglé ses enfants, les ait jetés dans le puits de la cour ? C’est néanmoins ce que colporta la rumeur et c’est ainsi que me fut contée l’histoire…
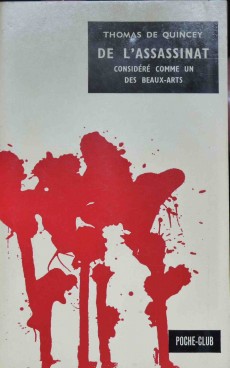
Plus tard j’en appris une autre, sanglante celle-ci, et aussi brutale que les meurtres de John Williams rapportés par Thomas de Quincey dans son essai « De l’assassinat considéré comme un des Beaux-Arts ». Le ou les tueurs n’avaient jamais été retrouvés qui avaient égorgé au rasoir dans une rare violence, un soir d’octobre de l’année 1960, les aubergistes du Café du Terminus, en face de la gare des Charentes. Le café a été démoli depuis; on l’a remplacé par un terre-plein arboré dont l’emprise au sol rappelle exactement l’emplacement du bistrot… On trouve ce récit dans la collection « Les Grandes Affaires Criminelles », publiées par les Editions de Borée, dans le volume (T.2) concernant le département de la Haute-Vienne.
Enfin un crime abominable, celui-ci accompli par un attroupement de paysans, m’a longtemps frappé qui fut commis sur la personne de Monsieur de Moneys, dans le village de Hautefaye, en Périgord, dans le Nontronnais, le 16 août 1870. J’avais découvert étant jeune, dans la maison de campagne de mon arrière grand mère, les coupures de journaux qu’elle avait conservées du « Courrier du Centre », où cette affaire avait été relatée en feuilleton. Illustrées de gravures montrant les têtes patibulaires des tueurs, le « crochet » de chiffonnier de l’un d’eux, les masures où on avait traîné le corps ensanglanté de la victime et la mare asséchée dans laquelle on l’avait fait brûler respirant encore, ces illustrations avaient de quoi frapper l’imagination !
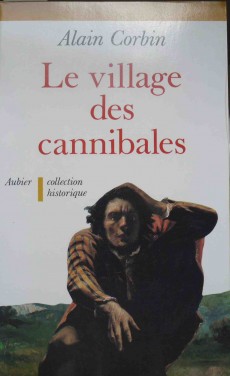
Je ne suis jamais allé à Hautefaye, encore que le plan soit connu du « trajet » de la victime. Les lieux ne doivent pas avoir beaucoup changés. On lira cette affaire dans l’ouvrage remarquable d’Alain Corbin paru chez Aubier.
Les crimes de sang sont de loin les plus effrayants. Qui habiterait une maison où il a éclaboussé les murs et parfois jusqu’au plafond ? Qui habiterait le château d’Escoire ou certaine maison de Thorigné sur Due qui fit parler d’elle dans les conditions que l’on sait, il n'y à guère ?
Les lieux du crime ? A bien y réfléchir, et depuis que le monde est monde, il ne doit pas y avoir beaucoup d’endroits sur terre ou quelque meurtre n’ait été commis, en tout cas pour les villes et les campagnes habitées, pour ne pas dire « hallucinées » comme les voyait le poète Emile Verhaeren. Je me suis souvent fait cette remarque en me promenant dans Paris, le Paris historique qui connut les heures sombres de la Terreur ou, pour un oui pour un non, on vous trucidait allègrement au coin d’une rue ou dans l’ombre d’une porte cochère. Quant aux exécutions capitales, au temps où la guillotine fonctionnait sans interruption sur la place de la Révolution dite depuis « de la Concorde », qui saura nous dire combien de litres de sang ont saturé le pavé sous l’échafaud ?
Place du Bouffay, à Nantes, je songeais certain jour à la décapitation des demoiselles Vaz de Melo de la Métairie dont la plus jeune, Olympe, n’avait que quinze ans… C’était le jour même où, place Viarmes, à l’endroit précis marqué au sol par des pavés en croix, me revinrent en mémoire les mots lancés par Charette, fusillé là par la République en 1796: « Et pourtant, nous sommes la jeunesse du Monde ! »

Jeanne à Rouen, Charette à Nantes, Ney près de l’Observatoire à Paris, le Duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes, Giordano Bruno à Rome… combien d’autres ? La liste serait longue à dresser des crimes officiels, commis par des assassins bien souvent anonymes portant la robe, la chasuble, la tunique ou l’uniforme ! A peser ce qui dort en chacun de nous de Fouquier-Tinville ou de Torquemada, on se dit qu’il suffirait d’un rien pour expédier de l’autre côté l’adversaire, si l’on n’y prenait garde !
Aussi faut-il, sur les lieux du crime, se poser la question : « Cela a été et cela n’est plus… » en sachant qu’il ne s’agit pas d’un rêve, quelque impensable qu’ait pu être l’événement dont il a été le théâtre. Il semble que le sang soit là, encore tout frais, comme sur la clef du conte de Barbe-Bleue pour nous le rappeler ! Et des lieux terribles s’y prêtent, comme le terrain vague du « Dahlia Noir », les friches industrielles, les anciens abattoirs, les hangars abandonnés, les décharges publiques, qu’affectionnent les assassins soucieux de la discrétion ou de la mise en scène.

Qu’est-ce qui nous pousse, un jour ou l’autre, à aller voir de près le théâtre d’un drame, et bien souvent des années après qu’il ait eu lieu, sinon le besoin impérieux de « l’exorciser » ? de « communier secrètement » avec la victime ? D’imaginer deux secondes, deux secondes seulement qu’on ait été à sa place… Oui, à sa place ou peut-être à celle de l’assassin ?

Les crimes, aussi épouvantables soient-ils, relatés à la une des quotidiens ou des journaux spécialisés ( « Radar » de nos grands parents, ou « Détective »), ont toujours alimenté la littérature populaire et fait recette au Grand Guignol. Et pourquoi ? mais parce qu’ils « plaisent », en dépit de leur horreur même, par le pouvoir qu’ils ont de réveiller en chacun de nous, la peur du « Grand Méchant Loup » des contes de la veillée, la « fascination » devant le tigre.

Ainsi « aime »-t-on avoir peur, quelque envie qu’on en ait ; et sans doute parce que la peur est sage conseillère , mieux vaut ne pas la montrer ! C’est souvent la condition de la survie. Cela s’apprend et cela s’enseigne, au plan personnel comme au plan collectif. Les assassins de tout temps et de tous crins le savent bien, qui comptent sur elle pour alimenter leur palmarès. A y regarder de près c’est ce qui se passe : un chien vous mord quand il sent que vous avez peur. Et peut-être aussi parce qu’il a peur lui-même ?
Qui a dit : « Si les hommes sont si méchants, c’est parce qu’ils ont peur… » ?
Où en sommes-nous, aujourd’hui ?

Œuvres de Pierre BOUCHARDON :
Le mystère du château de Chamblas, (Albin Michel 1922)
Le crime de Vouziers, (Librairie Académique Perrin 1923)
L’auberge de Peyrebeille, (Albin Michel 1924)
L’affaire Lafarge, (Albin Michel 1924)
La tragique histoire de l’instituteur Lesnier, (Librairie Académique Perrin 1925)
Le crime du château de Bitremont, (Albin Michel 1925)
La fin tragique du Maréchal Ney, (Hachette 1925)
L’énigme du cimetière Saint Aubin, (Albin Michel 1926)
Le Magistrat, (Hachette 1926)
Le duel du chemin de la Favorite, (Albin Michel 1927)
La tuerie du pont d’Andert, (Librairie Académique Perrin 1928)
Les dames de Jeufosse, (Albin Michel 1928)
Célestine Doudet, institutrice, (Albin Michel 1928)
L’auberge de la Tête Noire, (Librairie Académique Perrin 1928)
Les procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1928)
Le Docteur Couty de la Pommeraie, (Albin Michel 1929)
Le banquier de Pontoise, (Edition des Portiques 1929)
L’enfant de la Villette, (Nouvelle Revue Critique 1930)
Autres procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1930)
Le cocher de Monsieur Armand, (Edition des Portiques 1930)
Ravachol et Cie, (Hachette 1931)
L’Abbé Delacollonge, (Librairie Alphonse Lemerre 1931)
Troppmann, (Albin Michel 1932)
L’homme aux oreilles percées, (Nouvelle Revue Critique 1932)
La faute de l’Abbé Auriol, (Nouvelle Revue Critique 1933)
La malle mystérieuse, (Albin Michel 1933)
L’affaire Pranzini, (Albin Michel 1934)
Un précurseur de Landru, l’horloger Pel, (Arthaud 1934)
L’assassin X, (Albin Michel 1935)
La dernière guillotinée, (Nouvelle Revue Critique 1935)
Dumollard, le tueur de bonnes, (Albin Michel 1936)
Hélène Jégado, l’empoisonneuse bretonne, (Albin Michel 1937)
Vacher, l’éventreur, (Albin Michel 1939)
Le puits du presbytère d’Entrammes, (Albin Michel 1942)
Madame de Vaucrose, (Albin Michel 1947)
Souvenirs, (Albin Michel 1953)
Orientations :
Editions de BOREE : Collection « Les Grandes Affaires Criminelles ».
Alain CORBIN : Le village des cannibales, Aubier collection historique, 1990.
James ELLROY : Tous les ouvrages parus aux éditions Payot, collection Rivages Noir, et particulièrement « Ma part d’ombre », « Le Dahlia Noir » et « Un tueur sur la route ».
Emile GABORY : Les guerres de Vendée, Laffont, collection Bouquins.
Thomas de QUINCEY : De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts, Poche-Club, Nouvel Office d’Edition 1963.
Charles RIVET : Mémoire noire, Editions René Dessagne.
17:00 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : crimes, meurtres, assassinat, bouchardon, troppmann, sang, hautefaye, peyrebeille, guillotine



