07/08/2017
RETOUR CHEZ BICHETTE
C’était il y a longtemps, trente ans ? Peut-être plus, quarante à tout le moins…

Derrière les pompes à essence j’avais poussé la porte qui s’ouvrait sur la salle du bistrot, sombre, pas très grande, éclairée par l’unique fenêtre regardant la place de l’église masquée en partie par les pompes à essence. Le patron essuyait des verres qu’il tirait d’une bassine placée derrière le comptoir à l’extrémité duquel un vieux sirotait son verre de blanc. De lourdes mouches, volant dans la pénombre, venaient régulièrement se cogner aux vitres de la fenêtre ou à celles de la porte…
A l’époque, je sillonnais la Creuse à la faveur du temps libre que m’accordaient les permanences assumées à Felletin comme maître d’internat au collège. J’appris ainsi à aimer ces terres oubliées de l’extrême centre de la France où je découvris des paysages et des personnages hors du commun. Sur les traces des tailleurs de pierre, je m’arrêtai un jour à Sardent où des réfugiés italiens étaient venus exercer leur art de tailler le granite. Dans les bois avoisinant le bourg, je trouvai des témoins de leur labeur, de gros blocs équarris, des linteaux taillés et des pierres d’angle disséminés ça et là, sous l’humus et les feuilles mortes. Travail de titans, travail de bagnards !
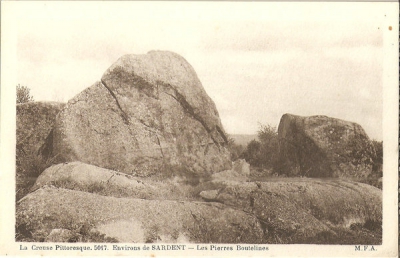
Du granite, à Sardent, il y en a partout, du coriace, de celui qui résiste au ciseau à pas vouloir se laisser dompter facile ! Pas né d’hier dans l’antre de Pluton, pour des enfants de chœur ! En témoignent l’amoncellement de blocs du monument qu’éleva Evariste Jonchère en mémoire du docteur Vincent, bienfaiteur local, ainsi que le nom de la commune écrit en parpaings de granite en façon de balustrade sur la place.

Des souvenirs, à Sardent, il y en a partout aussi, et pas seulement de ceux laissés par les maçons. C’est ici que l’enfant du pays, le cinéaste Claude Chabrol tourna « Le Beau Serge » avec Bernadette Lafont et Jean-Claude Brialy dans l’hiver 57-58, il y a 60 ans.

Depuis, rien n’a changé ou si peu, la campagne et le bourg sont restés les mêmes, et il semble qu’ici, à Sardent comme en beaucoup d’endroits de Creuse le temps se soit arrêté, du moins chez Bichette.
J’y suis revenu il n’y a guère plus de quinze jours ; j’ai, pour la seconde fois poussé la porte, la deuxième, vitrée, perpendiculaire à celle de la rue. On la referme à cause des courants d’air attendu que la fenêtre, elle, reste ouverte quasi en permanence l’été durant.

Monsieur Peyrot, le patron à son comptoir
A l’intérieur, miracle, tout ou presque est demeuré en l’état, jusqu’aux photos et coupures de presse punaisées sur le mur en vis à vis de la grande cheminée. Un seul client accoudé au zinc devise avec le patron. La salle est sombre, il y faut de la lumière et ce qu’elle éclaire, cette lumière, ce sont les derniers vestiges d’une civilisation en voie de disparition, celle qui n’imposait rien ou si peu, en matière de « respects de normes » toutes plus tyranniques les unes que les autres.

La vieille horloge marque toujours l'heure...
Le patron, Monsieur Peyrot, qui a pris la suite de son frère nous l’explique. Que de chicanes ne lui a-t-on fait ! Que de poux dans la tête ne lui a-t-on cherchés ? L’électricité n’est pas aux normes, et alors, cela empêche-t-il la lumière de briller ? Il n’y a ni l’eau courante ni de frigo derrière le comptoir, et alors ? L’eau coule dans l’arrière cuisine à côté du frigo et il suffit de quelques pas pour l’aller quérir. Le patron lave ses verres dans la cuve du zinc comme il lui plaît, les essuie méticuleusement et je peux en témoigner : ils sont propres !

Accès à la cour et porte voutée de la cave derrière le comptoir.
Le chauffage est assuré par un gros poêle sous la cheminée, ce qui n’est plus admis à causes des risques d’asphyxie ! Diable, personne n’a eu pour le moment à s’en plaindre s’étant trouvé fort à son aise de bénéficier de sa chaleur en l’hiver venu.
Aux dernières nouvelles, des contrôleurs, dépêchés tout spécialement de Limoges ont fait observer qu’il serait bon de déposer le sol, pas moins ! D’arracher sans différer les lourdes dalles de granite qu’ont foulées des générations de moines et de voyageurs, car comme nous l’explique Monsieur Peyrot, la maison fut prieuré puis relais de poste aux chevaux avant d’être le bistrot que la famille Peyrot s’est transmis de père en fils.

Devant la cheminée. Au mur, au centre des affiches, derrière le papier vert, petit placard de l'électricité...
Mais au fait, pourquoi déposer ces dalles ? Ah ! Bon Dieu mais à cause du radon bien sûr ! Lequel s’il faut en croire ces zélés inspecteurs, diffusera forcément un jour où l’autre par les jointures à seules fins d’éliminer les consommateurs…
De consommateurs, il faut l’avouer, nous ne fûmes, le temps de deviser, que deux ou trois. Assurément parce qu’il faut être un habitué des lieux pour savoir qu’il existe un bistrot derrière les pompes ! Rien ne l’indique plus aujourd'hui, Monsieur Peyrot se contente de ses pratiques habituelles et cela lui va.
De l’autre côté de la place, en contre bas de la balustrade, la terrasse du café bar regardant le midi fait le plein, en raison d’une course de motos tous terrains. En philosophe averti, le patron de Chez Bichette n’en prend pas ombrage, son petit picotin lui va et il s’en trouve bien.
Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce qu’obligation lui soit faite de fermer ses portes à défaut de vouloir respecter les normes imposées par la technocratie post-orwellienne qui, comme le couperet de la guillotine, vous coupent le bec une fois pour toutes.
Alors, si vous passez un jour à Sardent, ne manquez pas d’aller saluer le dernier résistant des troquets d’antan, Monsieur Peyrot, Bernadette vous le suggère, mais un conseil : faites vite !

Bernadette Lafont lors du tournage du Beau Serge.
19:19 Publié dans carnet de route | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bistro, sardent, bichette, essence, comptoir, creuse, pierre, granite, ciseau, pluton, choeur, monument, chabrol, bernadette, zinc, normes, frigo, eau, électricité, patron, chauffage, poste, chevaux, générations, consommateurs, guillotine, troquet
27/06/2010
LIEUX DU CRIME

L’assassin est un peintre au couteau qui dispose les objets de son crime comme l’artiste le fait d’une nature morte sur sa toile. Tout est arrangé à dessein de façon à « séduire » c’est-à-dire à impressionner le spectateur.
Le procédé est toujours le même : le peintre, ou le meurtrier professionnel, sélectionne ce qui en premier frappera l’observateur ; il calcule, analyse et s’applique à l’ouvrage du mieux qu’il peut. La pratique aidant, il le fait machinalement. Ayant en quelque sorte obtenu son brevet de maîtrise, il s’attache à transmettre son art ou à garder jalousement le secret de ses compositions. Le meurtrier occasionnel, lui, emporté par ses humeurs, n’obéissant qu’à l’aveuglement de sa passion, reste un amateur et gâche la toile.
On ne saura jamais quels soins apporta Chardin à ses natures mortes, mais ce que remarquèrent les artistes qui traitèrent de semblables sujets, c’est que toujours, « quelque chose » dépassait du bord du support de la composition : une feuille de vigne, un poireau, la patte d’un lièvre ou la pince d’un homard, mais plus généralement, le manche d’un couteau…

Le procédé ne date pas d’hier, mais sans doute de l’invention de la perspective ; les maîtres flamands en ont usé dès l’instant où ils ont compris quel avantage il accordait à la lecture de l’oeuvre en soulignant la profondeur de champs et la valeur du plan de la scène.
« Mon grand-père m’attendait dans son fauteuil de velours d’Utrecht. Je m’asseyais du côté de sa bonne oreille, car, depuis l’enfance, il était sourd de l’oreille droite, et, sous mes questions, sa langue n’était pas longue à se délier. Je réclamais le plus souvent, tant l’attrait m’en semblait inépuisable, l’histoire de l’Assassinat du petit garçon.
Il s’agissait d’un enfant de cinq ans qu’à l’époque des vacances de 1845, ses parents avaient abandonné dans leur maison de campagne sise à dix kilomètres d’Aubusson, à la garde d’une vieille femme de confiance. Tous les deux –le petit maître et la gouvernante- occupaient le même lit. Par une nuit d’étoiles, quelqu’un était venu, avait défoncé la fenêtre et, bondissant dans la pièce, un marteau de maçon à la main, s’était livré à une effroyable tuerie…
Le soir, quand je me retrouvais dans mon petit lit et que mes parents, après avoir emporté la lumière, me laissaient à mon sommeil ou à mes pensées, je frissonnais de tous mes membres. Le vent sous le rideau de la cheminée, un craquement dans les boiseries, un bruit de pas, le grincement d’une girouette, il n’en fallait pas davantage pour que mon cœur battit à coups précipités. Mais si je parvenais quelquefois à commander à mes angoisses, que devenais-je, grand Dieu ! quand le rêve m’emportait au pays de l’épouvante ? Brusquement, je me trouvais seul dans la maison du crime, en pleine nuit et loin de tout secours. Et, pendant que, les pieds cloués au sol, je cherchais en vain à crier ou à m’enfuir, l’assassin s’avançait vers moi en levant son marteau… »
Ainsi s’exprime Pierre Bouchardon dans ses « Souvenirs » qui furent édités en 1953.
Les œuvres de cet ancien magistrat, né à Guéret le 9 avril 1870, connurent un succès populaire par le fait qu’elles rapportaient, non seulement les procès des grandes affaires criminelles du temps, mais aussi des meurtres plus anciens inscrits au registre des classiques en la matière.
La plupart de ces récits, publiés par Albin Michel, sont encore assez faciles à trouver chez les bouquinistes ou sur le net, avec un peu de patience.
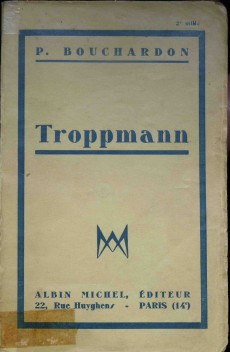
J’ai découvert cet auteur en achetant son « Troppmann » à un bouquiniste du Quai de la Mégisserie en 1970. J’ignorais tout de ce crime à faire « dresser les cheveux sur la tête ». Il eut lieu en 1869 en bordure du chemin Vert, dans la plaine de Pantin… Bouchardon le relate tel quel, dans toute son horreur. Ce magistrat, qui fut successivement juge, procureur de la République, chef du bureau des Affaires criminelles au Ministère de la Justice, président de la Cour d’appel de Paris et conseiller à la Cour de cassation, n’y va pas par quatre chemins et son art de narrateur, tout empreint de la faconde des tribunaux, nous transporte comme si nous assistions au procès, dans la salle d’audience…
Il nous emmène de la même manière sur les lieux du crime et nous fait partager, les yeux grand ouverts, ce que découvrirent les premiers témoins.
Sans doute l’ assassinat du petit garçon eut-il sa part dans la vocation de Pierre Bouchardon ; il le confesse d’ailleurs lui-même dans ses « Souvenirs » : « L’affaire m’obséda à ce point qu’elle ne fut pas étrangère, je le peux croire, à ma décision d’entrer dans la magistrature. » Et, comme il était doué pour écrire, il mit ses dons de narrateur au service de sa plume et nous laissa plus de trente récits, plus terribles les uns que les autres, dont on trouvera la liste en fin de note.
Tels nous surprendront à les relire « Le Crime de Vouziers », « L’Enfant de la Villette », « Le Puits du Presbytère d’Entrammes » ou « L’Affaire Pranzini ». Quant à l’auberge de Peyrebeille, dite « l’Auberge Rouge », sise sur la grand route du Puy à Aubenas, sans doute ne saura-t-on jamais exactement ce qu’il en fut, même si l’on se plaît à montrer au visiteur le four, la « poutre tragique », les chambres maudites… Ce qui est sûr c’est que tombèrent au milieu de la cour sous le couperet les deux têtes des époux Martin et celle de leur domestique Rochette. Une pierre dressée en marque l’emplacement exact.
Je n’ai point, pour ma part, embrassé la carrière de magistrat bien que j’ai été frappé et au même âge, tout autant qu’a pu l’être Pierre Bouchardon, par le récit que me fit ma grand-mère d’un crime abominable ayant eu lieu non loin de la propriété que nous occupions alors à Limoges, dans le quartier du quai Militaire. Souvent, je passais près de la maison du drame, aujourd’hui disparue… Elle occupait, au débouché du tunnel du chemin de fer au lieu dit le Puy-Imbert, l’angle d’une rue ; une grande maison carrée en face d’un lavoir, avec un jardin attenant livré aux broussailles… Et toutes les fois je me disais : « C’est là ! ».
Oui, c’était là qu’un jour de 1889, dans la nuit du 9 au 10 avril, une pauvresse, la femme Souhin, chiffonnière de son état, avait étranglé ses quatre petits dont les âges s’échelonnaient entre onze ans pour l’aîné des garçons et quelque mois pour la dernière-née. Ce que trouva à dire la criminelle qui ne pu, en dépit de ses tentatives parvenir à mettre un terme à ses jours, c’est qu’elle avait été contrainte de tuer ses enfants ne pouvant les nourrir, poussée à l’extrême pauvreté accrue par l’arrestation de son mari, auteur de quelque larcin. C’était un crime de la misère qu’avaient caché ces murs gris et austères ; fallait-il ajouter à l’horreur de ce quintuple infanticide le fait que leur mère, après avoir étranglé ses enfants, les ait jetés dans le puits de la cour ? C’est néanmoins ce que colporta la rumeur et c’est ainsi que me fut contée l’histoire…
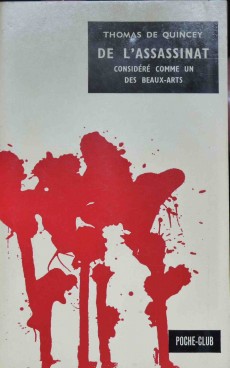
Plus tard j’en appris une autre, sanglante celle-ci, et aussi brutale que les meurtres de John Williams rapportés par Thomas de Quincey dans son essai « De l’assassinat considéré comme un des Beaux-Arts ». Le ou les tueurs n’avaient jamais été retrouvés qui avaient égorgé au rasoir dans une rare violence, un soir d’octobre de l’année 1960, les aubergistes du Café du Terminus, en face de la gare des Charentes. Le café a été démoli depuis; on l’a remplacé par un terre-plein arboré dont l’emprise au sol rappelle exactement l’emplacement du bistrot… On trouve ce récit dans la collection « Les Grandes Affaires Criminelles », publiées par les Editions de Borée, dans le volume (T.2) concernant le département de la Haute-Vienne.
Enfin un crime abominable, celui-ci accompli par un attroupement de paysans, m’a longtemps frappé qui fut commis sur la personne de Monsieur de Moneys, dans le village de Hautefaye, en Périgord, dans le Nontronnais, le 16 août 1870. J’avais découvert étant jeune, dans la maison de campagne de mon arrière grand mère, les coupures de journaux qu’elle avait conservées du « Courrier du Centre », où cette affaire avait été relatée en feuilleton. Illustrées de gravures montrant les têtes patibulaires des tueurs, le « crochet » de chiffonnier de l’un d’eux, les masures où on avait traîné le corps ensanglanté de la victime et la mare asséchée dans laquelle on l’avait fait brûler respirant encore, ces illustrations avaient de quoi frapper l’imagination !
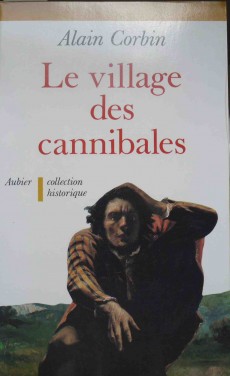
Je ne suis jamais allé à Hautefaye, encore que le plan soit connu du « trajet » de la victime. Les lieux ne doivent pas avoir beaucoup changés. On lira cette affaire dans l’ouvrage remarquable d’Alain Corbin paru chez Aubier.
Les crimes de sang sont de loin les plus effrayants. Qui habiterait une maison où il a éclaboussé les murs et parfois jusqu’au plafond ? Qui habiterait le château d’Escoire ou certaine maison de Thorigné sur Due qui fit parler d’elle dans les conditions que l’on sait, il n'y à guère ?
Les lieux du crime ? A bien y réfléchir, et depuis que le monde est monde, il ne doit pas y avoir beaucoup d’endroits sur terre ou quelque meurtre n’ait été commis, en tout cas pour les villes et les campagnes habitées, pour ne pas dire « hallucinées » comme les voyait le poète Emile Verhaeren. Je me suis souvent fait cette remarque en me promenant dans Paris, le Paris historique qui connut les heures sombres de la Terreur ou, pour un oui pour un non, on vous trucidait allègrement au coin d’une rue ou dans l’ombre d’une porte cochère. Quant aux exécutions capitales, au temps où la guillotine fonctionnait sans interruption sur la place de la Révolution dite depuis « de la Concorde », qui saura nous dire combien de litres de sang ont saturé le pavé sous l’échafaud ?
Place du Bouffay, à Nantes, je songeais certain jour à la décapitation des demoiselles Vaz de Melo de la Métairie dont la plus jeune, Olympe, n’avait que quinze ans… C’était le jour même où, place Viarmes, à l’endroit précis marqué au sol par des pavés en croix, me revinrent en mémoire les mots lancés par Charette, fusillé là par la République en 1796: « Et pourtant, nous sommes la jeunesse du Monde ! »

Jeanne à Rouen, Charette à Nantes, Ney près de l’Observatoire à Paris, le Duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes, Giordano Bruno à Rome… combien d’autres ? La liste serait longue à dresser des crimes officiels, commis par des assassins bien souvent anonymes portant la robe, la chasuble, la tunique ou l’uniforme ! A peser ce qui dort en chacun de nous de Fouquier-Tinville ou de Torquemada, on se dit qu’il suffirait d’un rien pour expédier de l’autre côté l’adversaire, si l’on n’y prenait garde !
Aussi faut-il, sur les lieux du crime, se poser la question : « Cela a été et cela n’est plus… » en sachant qu’il ne s’agit pas d’un rêve, quelque impensable qu’ait pu être l’événement dont il a été le théâtre. Il semble que le sang soit là, encore tout frais, comme sur la clef du conte de Barbe-Bleue pour nous le rappeler ! Et des lieux terribles s’y prêtent, comme le terrain vague du « Dahlia Noir », les friches industrielles, les anciens abattoirs, les hangars abandonnés, les décharges publiques, qu’affectionnent les assassins soucieux de la discrétion ou de la mise en scène.

Qu’est-ce qui nous pousse, un jour ou l’autre, à aller voir de près le théâtre d’un drame, et bien souvent des années après qu’il ait eu lieu, sinon le besoin impérieux de « l’exorciser » ? de « communier secrètement » avec la victime ? D’imaginer deux secondes, deux secondes seulement qu’on ait été à sa place… Oui, à sa place ou peut-être à celle de l’assassin ?

Les crimes, aussi épouvantables soient-ils, relatés à la une des quotidiens ou des journaux spécialisés ( « Radar » de nos grands parents, ou « Détective »), ont toujours alimenté la littérature populaire et fait recette au Grand Guignol. Et pourquoi ? mais parce qu’ils « plaisent », en dépit de leur horreur même, par le pouvoir qu’ils ont de réveiller en chacun de nous, la peur du « Grand Méchant Loup » des contes de la veillée, la « fascination » devant le tigre.

Ainsi « aime »-t-on avoir peur, quelque envie qu’on en ait ; et sans doute parce que la peur est sage conseillère , mieux vaut ne pas la montrer ! C’est souvent la condition de la survie. Cela s’apprend et cela s’enseigne, au plan personnel comme au plan collectif. Les assassins de tout temps et de tous crins le savent bien, qui comptent sur elle pour alimenter leur palmarès. A y regarder de près c’est ce qui se passe : un chien vous mord quand il sent que vous avez peur. Et peut-être aussi parce qu’il a peur lui-même ?
Qui a dit : « Si les hommes sont si méchants, c’est parce qu’ils ont peur… » ?
Où en sommes-nous, aujourd’hui ?

Œuvres de Pierre BOUCHARDON :
Le mystère du château de Chamblas, (Albin Michel 1922)
Le crime de Vouziers, (Librairie Académique Perrin 1923)
L’auberge de Peyrebeille, (Albin Michel 1924)
L’affaire Lafarge, (Albin Michel 1924)
La tragique histoire de l’instituteur Lesnier, (Librairie Académique Perrin 1925)
Le crime du château de Bitremont, (Albin Michel 1925)
La fin tragique du Maréchal Ney, (Hachette 1925)
L’énigme du cimetière Saint Aubin, (Albin Michel 1926)
Le Magistrat, (Hachette 1926)
Le duel du chemin de la Favorite, (Albin Michel 1927)
La tuerie du pont d’Andert, (Librairie Académique Perrin 1928)
Les dames de Jeufosse, (Albin Michel 1928)
Célestine Doudet, institutrice, (Albin Michel 1928)
L’auberge de la Tête Noire, (Librairie Académique Perrin 1928)
Les procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1928)
Le Docteur Couty de la Pommeraie, (Albin Michel 1929)
Le banquier de Pontoise, (Edition des Portiques 1929)
L’enfant de la Villette, (Nouvelle Revue Critique 1930)
Autres procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1930)
Le cocher de Monsieur Armand, (Edition des Portiques 1930)
Ravachol et Cie, (Hachette 1931)
L’Abbé Delacollonge, (Librairie Alphonse Lemerre 1931)
Troppmann, (Albin Michel 1932)
L’homme aux oreilles percées, (Nouvelle Revue Critique 1932)
La faute de l’Abbé Auriol, (Nouvelle Revue Critique 1933)
La malle mystérieuse, (Albin Michel 1933)
L’affaire Pranzini, (Albin Michel 1934)
Un précurseur de Landru, l’horloger Pel, (Arthaud 1934)
L’assassin X, (Albin Michel 1935)
La dernière guillotinée, (Nouvelle Revue Critique 1935)
Dumollard, le tueur de bonnes, (Albin Michel 1936)
Hélène Jégado, l’empoisonneuse bretonne, (Albin Michel 1937)
Vacher, l’éventreur, (Albin Michel 1939)
Le puits du presbytère d’Entrammes, (Albin Michel 1942)
Madame de Vaucrose, (Albin Michel 1947)
Souvenirs, (Albin Michel 1953)
Orientations :
Editions de BOREE : Collection « Les Grandes Affaires Criminelles ».
Alain CORBIN : Le village des cannibales, Aubier collection historique, 1990.
James ELLROY : Tous les ouvrages parus aux éditions Payot, collection Rivages Noir, et particulièrement « Ma part d’ombre », « Le Dahlia Noir » et « Un tueur sur la route ».
Emile GABORY : Les guerres de Vendée, Laffont, collection Bouquins.
Thomas de QUINCEY : De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts, Poche-Club, Nouvel Office d’Edition 1963.
Charles RIVET : Mémoire noire, Editions René Dessagne.
17:00 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : crimes, meurtres, assassinat, bouchardon, troppmann, sang, hautefaye, peyrebeille, guillotine
21/01/2010
21 JANVIER 1793

« Mon père resta avec son confesseur, se coucha à minuit et dormit jusqu'à 5 heures qu'il fut réveillé par le tambour. A 6 heures, l'abbé Edgeworth de Firmont dit la messe. Il partit à 9 heures... Il reçut le coup de la mort le 21 janvier 1793 à 10 heurs 10 minutes du matin (1). Ainsi périt Louis XVI, roi des Français, âgé de trente-neuf ans, cinq mois, et trois jours, après avoir régné 18 ans. Il avait été en prison 5 mois et 8 jours... »
C'est ce qu'écrit Madame Royale, fille de l'infortuné Louis XVI...

Qu'on imagine ce roi, qui n'en est pas moins homme, isolé des siens, ne recevant pour tout soutien dans sa geôle que les attentions dévouées de son valet Cléry et celles de son confesseur lui prodiguant les secours de la religion ; qu'on l'imagine le 20 janvier, à « deux heures après midi », à l'écoute de l'arrêt de mort dont on lui donne lecture... Qu'on l'imagine encore, au matin de son dernier jour, guettant les bruits de pas et le mouvement des troupes sur les pavés du Temple, attendant qu'on cogne à la porte...

Edmond Biré, auquel on doit le « Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur », retrace fidèlement, puisant aux meilleures sources, ce que furent les dernières heures du Roi.
« Six heures du matin. Il pleut toujours. On continue à battre la générale la nuit du 20 au 21 avait été pluvieuse et froide. Le matin la pluie continua. Cette pluie persistante avait fait disparaître en partie la neige qui, la veille, couvrait Paris comme un vaste linceul. Des patrouilles circulaient lentement dans les rues. Dans tous les quartiers on battait la générale... »
Il fait froid ce matin du 21 janvier, et aux dires de témoins oculaires, la pluie ayant cessé, un brouillard assez dense et glacé couvre la ville. Place de la Révolution, ex-place Louis XV actuellement place de la Concorde, le bourreau avait pris la précaution de dépêcher suffisamment tôt les charpentiers pour dresser les bois de justice.

Une foule importante, contenue en partie par les troupes s'avance jusqu'au pied de la guillotine en attente du lever de rideau...
C'est l'heure... Santerre, suivi de 10 gendarmes vient chercher « L'individu déclaré roi des Français » (Danton) à 9 heures. Le Roi n'a que le temps de remettre à Godeau, membre de la Commune, un papier pour la Reine ; c'est le testament qui nous est parvenu, précieux document, rédigé le 25 décembre, jour de Noël.
La berline, dans laquelle a pris place le condamné à mort, roule au pas de l'infanterie, entre une triple allée d'hommes armés. Il lui faut plus d'une grande heure pour parvenir au terme du voyage. Le Roi, au côté de son confesseur, indifférent à ce qui se passe au-dehors, lit des psaumes en vis-à-vis des deux gardes qui le surveillent...
Rendu au pied de l'échafaud, il quitte lui-même l'habit dont il n'a plus besoin, et retrousse le col de sa chemise. Il refuse qu'on lui lie les mains mais devant l'insistance des aides du bourreau, il cède, encouragé par son confesseur en s'exclamant : « Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la lie. » Madame Royale rapporte qu'on lui lia les mains avec son mouchoir et non avec une corde. Aidé par son confesseur, il monte les degrés abrupts de l'échelle de meunier jusqu'à la plateforme qu'il traverse d'un pas assuré.

Le roulement des tambours ne s'est jamais interrompu ; néanmoins le Roi parvient, par un signe, à les faire taire le temps de dire d'une voix portant jusqu'au Pont Tournant : « Je meurs innocent des crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que mon sang ne retombe jamais sur la France... ». Il veut poursuivre, mais sur l'ordre de Santerre, les tambours reprennent leur roulement et couvrent sa voix... Puis tout va très vite, les aides se saisissent du condamné, le couchent sur la planche à bascule, ferment la lunette... Sanson libère le couperet qui s'abat dans un bruit sourd : « le cou du Roi était très fort... la tête ne se détacha pas entièrement sous le tranchant. On du appuyer sur le triangle pour achever de la séparer du corps... le couteau ne retomba pas sur le cou, mais sur l'occiput, c'est-à-dire trop haut, de sorte que la mâchoire fut horriblement coupée. » C'est ce que rapporte Maurice de la Fuye dans son étude, puis il poursuit : « C'est, autour de la guillotine, une saturnale dégoûtante, une danse macabre, au-dessus de laquelle retentit la Marseillaise. »
L'un des aides du bourreau, s'emparant de la tête par les cheveux, la promène en dansant autour de la plateforme ; un homme plonge ses mains dans le sang figé et, asperge la foule de caillots en s'écriant : « Les rois ont dit : Si vous faites mourir votre souverain, son sang retombera sur vos têtes... Eh bien ! la prédiction est accomplie ! »

Des sectionnaires rougissent leurs sabres et leurs piques en les plongeant dans la cuve ; la plateforme est envahie et les bourreaux ont du mal à contenir les plus enragés. Certains se barbouillent le visage de sang et, rapportent les témoins : « d'autres le goûtent et semblent le savourer, cependant que l'un d'eux s'écrie en grimaçant qu'il est bougrement salé ! »
Puis, on se partage les dépouilles, un étranger paie 15 livres une touffe des cheveux, d'autres trempent leur mouchoir dans le sang royal ou, comme le fit Monsieur de la Roserie, une enveloppe, pour l'envoyer à sa mère... Les effets du mort sont déchiquetés et partagés entre les assistants ; le cadavre ne gardera que sa chemise, sa culotte et ses bas gris (Procès-verbal d'inhumation).
On se posera la question de savoir s'il s'agit là de profanation sacrilège ou de culte pieux des reliques. Ce qui fera dire à Joseph de Maistre : « Il semble qu'au pied de l'échafaud de Louis XVI, amis et ennemis du prince immolé se soient rencontrés pour apporter un témoignage involontaire en faveur du « Salut par le sang ».
A la liesse collective succèdera bientôt un morne silence. Dans ses Mémoires, le Chancelier Pasquier rapporte que « Le reste du jour se passa dans une profonde stupeur ; elle s'était étendue à la ville entière... ».
Le corps et la tête de l'infortuné monarque seront transportés jusqu'au cimetière de la rue d'Anjou Saint Honoré ; ils y resteront jusqu'en 1814, date à laquelle, grâce à Descloseaux ils rejoindront la basilique de Saint Denis.

Les journaux du temps ont rapporté l'événement dans sa vérité et sa cruauté ; le Républicain le 22 janvier 1793, le Journal de Perlet, et le Nouveau Paris de Mercier, à la même date. Cléry a retracé les derniers moments du Roi dans son « Journal de ce qui s'est passé à la cour du Temple ». Et Rivarol pouvait écrire dans le sien :
« L' Assemblée Constituante tua la royauté, et par conséquent le roi ; la Convention ne tua que l'homme. La première fut régicide, et l'autre parricide. La victime était parée, les jacobins n'eurent qu'à appliquer la hache. Comme roi, Louis XVI mérita ses malheurs parce qu'il ne sut pas faire son métier ; comme homme, il ne les méritait pas. Ses vertus le rendirent étranger à son peuple. »
Rappelons que l'Assemblée, n'a voté « la mort sans condition », que par une majorité de 3 voix et qu' au nombre des régicides il faut compter Philippe d'Orléans, dit « Philippe Egalité ». On rivalisait de zèle homicide et de cruauté sous la Terreur ; rien d'étonnant dès lors à ce qu'il se soit trouvé parmi les furieux des hommes de la trempe du député Legendre, qui demanda « qu'on déchire le corps de Capet en quatre-vingt-sept morceaux pour les distribuer aux départements. » et, ajoute l'historien Jules Mazé : « On peut penser qu'en sa qualité de boucher, il se fut volontiers chargé de l'opération... »
C'était il y a 217 ans ; c'était hier...

Lire le TESTAMENT de LOUIS XVI:
http://fr.wikisource.org/wiki/Testament_de_Louis_XVI
(1) Le Républicain du 22 janvier 1793 rapporte : 10H 24 minutes.
Lectures :
- Jules Mazé : La famille royale et la révolution ; Hachette 1943.
- Le Notre : La guillotine.
- Rivarol : Journal ; Editions du Rocher.
- Edmond Biré : Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur ; Librairie Académique Perrin (5 volumes), 1907.
- Maurice de la Fuye : Louis XVI, Denoël, 1943.
- de Beauchesne : Vie de Louis XVII
- Hippolyte Taine : Considérations sur les origines de la France Contemporaine, collection Bouquins, Laffont.
14:38 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : louis xvi, guillotine, révolution, concorde, sang



