25/05/2010
BULLETIN CELINIEN
Bulletin célinien N° 319
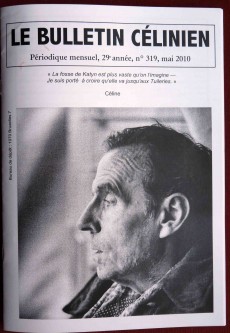
Outre un article de Max-Pol FOUCHET (De Giono à Céline) et la relation d'un « Entretien avec Henri GODARD » par Nicolas LEGER au sujet de l'édition de la « Correspondance » dans la Pléiade ; ce numéro de mai nous livre la recension par Marc LAUDELOUT, des derniers articles parus dans la presse concernant cette même correspondance. L'éditorialiste y donne également un aperçu de l'apparition du personnage de Céline dans des romans, suivi d'un clin d'œil à François SENTEIN (journaliste et écrivain décédé le 2 mars 2010), auteur d'un remarquable journal, « Minutes d'un libertin », réédité par les éditions Le Promeneur en deux volumes couvrant les années 1938-1941, et 1942-1943. Cette même maison reprend dans la foulée ses « Minutes d'un libéré (1944) et ses « Minutes d'une autre année » (1945).
Mais cette 319ème livraison est principalement consacrée au regard que porte Georges STEINER sur l'œuvre célinienne et en particulier sur la récente parution de la correspondance.
On trouvera sur Wikipédia un portrait de Georges Steiner.
Ce professeur de littérature comparée connu pour sa culture universelle et auquel les Cahiers de l'Herne ont consacré leur 80ème numéro en 2004 est aussi un essayiste, critique littéraire, poète et philosophe de renommée internationale. Il s'est intéressé - comment aurait-il pu faire l'impasse puisqu'elle est incontournable- à l'œuvre célinienne dont un côté le révolte et l'obsède, pendant que l'autre le laisse admiratif.
Il nous donne ici son point de vue sur les Lettres du volume de la Pléiade après avoir brossé un portrait mettant en relief la nature raciste viscérale et l'outrance antisémite qu'il trouve chez Céline.
Insistant particulièrement sur la « haine monstrueuse des juifs » de l'auteur des pamphlets et sur le fait qu'il n'y a rien à retenir de cette littérature de l'ordure, il précise: « Citer une seule phrase de ces harangues, cela soulève le cœur. C'est la pornographie de la haine ».
C'est là jugement sans appel, on en conviendra -mais bien hâtif néanmoins- d'un homme marqué au profond de son être par la Shoa, qui, par reductio ad hitlerum , en arrive à pousser l'ordure à l'ordure sans chercher à voir ce qu'elle peut renfermer de précieux. Il faut être assurément réductionniste et bien partisan pour ne rien vouloir garder des pamphlets qu'un souvenir où l'horreur le disputerait à l'abjection.
Il y a dans ces pages -et tous les céliniens le savent bien- des joyaux qui flottent sur la marée noire déversée par l'homme au milieu des ruines. Il faut prendre le temps, avec le recul, de les considérer pour ce qu'ils valent. C'est cela nous semble-t-il, affaire de temps, et Céline nous prévient: « Cela suffit au fond ces trois mots qu'on répète : le temps passe... cela suffit à tout...
Il n'échappe rien au temps... que quelques petits échos... de plus en plus sourds... de plus en plus rares... Quelle importance ? »
Et j'ai su, pour ma part, dès la lecture de Bagatelles, comment se présentait Saint Pétersbourg sans jamais y avoir été. Qui d'autre, en effet, mieux que ne l'a fait Céline, a su décrire en quelques mots seulement le visage de Léningrad ou celui de New-York ? C'est qu' il faut savoir prendre ce Janus « en bloc », ne rien rejeter et trouver, au-delà des mots, ce qu'ils « signifient », et pourquoi, et comment ils ont été « dits », car il s'agit d'un dire avant tout, et Céline n'est plus là pour en parler...
Céline est un « parleur », pour ne pas dire un conteur ; et Georges Steiner le sait bien qui note, au sujet des Lettres : « Contrairement à Flaubert ou à Proust, Céline ne visait pas à l'œuvre d'art en écrivant ses lettres. Il les écrit comme il respire. Il y a une constante : c'est sa voix, argotique, rageuse, moqueuse, impérieuse, parfois étonnamment tendre. »
Gustav Meyrink a dit: « pour voir le monde avec des yeux neufs, il faut avoir perdu ses yeux anciens à force de pleurer » ; saurons-nous jamais ce qu'il a versé de larmes, le « visionnaire » Céline, avant de déchaîner son déluge ?
G. Steiner, à la fin de sa note, rapporte cela : « Je n'oublie pas. Mon délire part de là ». D'où ? mais de la vraie nature de l'homme parbleu ! rappelons-nous Mea Culpa :
« L' Homme il est humain à peu près autant que la poule vole. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebecqueter la fiente . C'est sa nature, son ambition. Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. On cesse d'être si profond fumier que sur le coup d'une catastrophe. Quand tout se tasse à peu près, le naturel reprend le galop. »
L' aveuglant délire, celui qui emporte tout, il ne faut pas aller le chercher bien loin en nous, pour peu qu'on soit un « raffiné », un de ceux du côté d'Ariel plutôt que de Caliban, que la ruine d'une seule couvée d'oiseau par l'orage emporte. Combien en a-t-il vu de nids ruinés par l'orage d'acier Ferdinand, le cuirassier du 12ème de cavalerie ?
On peut le mesurer à l'aune de ce qu'il nous laissa dans le Voyage au bout de la nuit et qui lui fit dire : « Quand on sera au bord du trou faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie toute entière. »
Signalons pour conclure, la parution du numéro 5 des ETUDES céliniennes. Il renferme, entre autres, une étude d'Eric MAZET sur Céline à Sartrouville, ainsi qu'une autre, signée Pierre-Marie MIROUX éclairant la vie du cuirassier Destouches, au cours du mois de novembre 1914, à l'hôpital auxiliaire n°6 d'Hazebrouck.
(Ce numéro des "ETUDES" est à commander au coût de 25 euros + 5 euros de port au BC, BP 70, B 1000 Bruxelles 22 Belgique).
14:44 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : céline, pamphlets, bagatelles, mea culpa, georges steiner, marc laudelout, cuirassier, eric mazet
22/05/2010
TOUS LES PETITS ANIMAUX
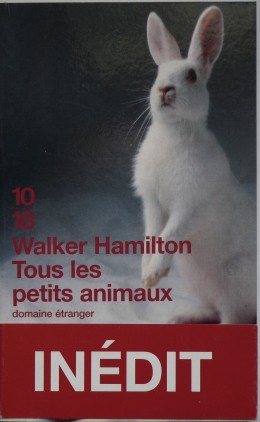
« ... la vache m'a vraiment fait peur. Elle est arrivée si doucement jusqu'à la maison délabrée que je ne me suis aperçu de sa présence que quand elle a ronflé juste dans mon oreille. J'ai bondi, et, un instant, j'ai cru que j'allais pleurer, mais tout allait bien, la vache s'est enfuie. Je pense qu'elle a dû être plus effrayée que moi. En me rasseyant, je me suis mis à rire, et M. Summers a eu un sourire qui ressemblait à une ride, sans montrer ses dents. M. Summers ne riait jamais.
- Tu sais ce que c'était, ça, mon garçon ? dit-il.
- C'était une vache.
- Il fit non de la tête.
- Euh... un taureau ?
- Non, non, mon garçon, pas un taureau.
- Ça ne peut quand même pas être un veau, j'ai dit, parce que les veaux sont plus petits.
- C'était la vie, mon garçon. La vie.
Ça s'embrouillait dans ma tête. Il me tardait que nous nous levions et que nous partions, comme ça je pourrais utiliser ma truelle toute neuve et me mettre au boulot, mais il fallait rester poli, alors j'ai demandé :
- Vous voulez dire qu'elle était vivante ?
- Je voulais dire que c'était LA VIE, mon garçon. La vie sous la forme d'une vache. Tu comprends ?
En fait non, je ne comprenais pas, et j'étais prêt à le lui dire, il ne faut pas mentir quand on a une conversation avec quelqu'un. Je devais avoir l'air d'être au bord des larmes parce que M. Summers m'a dit de ne pas m'en faire, qu'il allait m'apprendre et que j'aurais tout mon temps pour apprendre. »
Etrange livre que « Tous les petits animaux », unique ouvrage de Walker HAMILTON, fils de mineur, ancien pilote de la RAF, décédé prématurément à l'âge de 35 ans. Le roman fut porté à l'écran par Jeremy Thomas en 1998 avec John Hurt dans le rôle de M. Summers. L'action se déroule en Cornouailles et les deux protagonistes, Bobby Platt, trente et un an, demeuré simple d'esprit : « J'ai trente et un an. Je devrais être un homme, mais je me sens comme un petit garçon. » et Monsieur Summers, le « petit homme » auquel il est difficile de donner un âge, se rencontrent dans des circonstances propitiatoires qui feront de Bobby l'apprenti de M. Summers, lequel s'est donné pour mission de devoir enterrer tous les petits animaux écrasés sur la route.
Cette mission est une quête, celle de la vie, qu'il faut protéger et respecter même au-delà du trépas en enterrant les êtres. M. Summers s'est instauré fossoyeur des petits cadavres d'animaux victimes des automobilistes ; c'est un solitaire qui travaille à l'abri des regards et l'on sent bien vite que cet homme cache un secret qu'il ne livrera qu'au seul Bobby avant de mourir dans des circonstances tout aussi curieuses que celles qui lui firent rencontrer le garçon...
Bobby, persécuté par son odieux beau-père (le « Gros « ), qui le séquestre afin de régner seul sur la succession de sa mère, réussi à s'enfuir et, à bord d'un camion qui le prend en stop, à gagner les Cornouailles. Le chauffeur -autre manière de « Gros »- écrase volontairement un lapin et trouve la mort dans l'accident... Pas tout de suite ! le temps que Bobby se remette du choc et que le « petit homme » paraisse... Bobby veut porter secours au routier quand il entend derrière lui une petite voix : « Laissez-le... Cet homme est mauvais. Il a tué le lapin ».
Tout est dit et partant, le récit se déroule dans la bonne action d'enterrer les créatures et celle de devoir punir les méchants. Cette simplicité de vue n'en est pas moins déroutante. Rappelons nous la remarque de Ferdinand dans le Voyage au bout de la nuit : «Ça serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. »
Monsieur Summers, qui fait partie des bons en dépit de son « crime », ne savait assurément pas que sa mort lui arriverait par Bobby, peut être néanmoins le pressentait-il lorsqu'il le mit en demeure de ne jamais parler de lui : « ... ne dis jamais mon nom à personne. Une autre chose dont tu dois te souvenir. » Mais la vie est ainsi faite que la mort nous trouve là où elle doit nous cueillir sans que n'y puissions grand chose.
Bobby a du mal à suivre le petit homme qui souvent, s'esquive comme une ombre ; cependant il le retrouve toujours puisqu'il fait partie de son monde du dedans. Dans ses tribulations avec le monde du dehors, où qu'il aille, Bobby ne rencontre que l'hostilité des êtres ; ils relèvent tous de l'approximatif et représentent un danger réel. Le danger qui guette les simples, les innocents et les naïfs, qui se font facilement abuser.
Mais depuis la rencontre du petit homme, il semble que Bobby ait trouvé son chemin et que son « initiation » (enterrez les petits animaux) l'ait aidé à grandir et à trouver le sens de sa vie. Aussi, après la mort de Monsieur Summers, poursuivra-t-il le « travail » du vieil homme, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse pour chasser les ombres de la nuit et faire en sorte que demain, de nouveau, se lève le soleil.
Ce récit est court, à peine cent trente pages, mais vaut d'être lu, parce qu'il est le reflet d'un monde ignoré du plus grand nombre, habité par ceux là seuls qui ont le cœur assez pur pour voir les choses apparemment futiles, avec gravité...
16:39 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walker hamilton, bobby platt, m. summers, cornouailles, méchant, lapin, animaux
16/04/2010
BULLETIN CELINIEN

En couverture de ce 318ème numéro, nous voyons le haut d'un visage qui n'aboiera plus, celui de Céline sur son lit de mort... L'ermite de la Route des Gardes s'est tu définitivement le 1er juillet 1961, vers 18 heures... Rappelons-nous le début de « Mort à Crédit » : « Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste... Bientôt je serai vieux. Et ce sera enfin fini. »
Celui qui faisait partie des persécutés qu'évoque Chamfort dans l'une de ses maximes ( « En France , on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. » ) repose, comme endormi sur de la neige, dans la pénombre d'une pièce de la villa Maïtou...
Il n'y en avait guère, de neige, en ce premier juillet caniculaire de la mort de Céline, et l' article du bulletin qui nous décrit les dernières heures de sa vie, nous montre l'écrivain au bout de son voyage chercher la nuit, « sous la pierre de sa maison, brûlante comme la Casbah. Il ne supporte plus le soleil, sortant au crépuscule : « Je vais aux commissions. » Il rapporte la viande des bêtes, marcheur qui a perdu son ombre. Les gens de Meudon en le croisant auraient pu dire, comme les habitants de Vérone au sujet de Dante : « Eccovi l'uom ch'è stato all inferno » (Voyez l'homme qui a été en enfer). »
Du 25 ter de la route des Gardes à celle de Vaugirard, la ruelle aux bœufs a gardé l'ombre perdue de celui qui, tous les jours, se rendait aux « commissions », comme il disait. On l'imagine remontant les escaliers, traînant péniblement le sac lourd de provisions pour les bêtes...

Bas-Meudon, ruelle aux boeufs (source: topic-topos patrimoine-héritage)
« Je te dis que je vais crever ! » répète Céline... Chaleur étouffante dès le matin de ce samedi 1er juillet. Lucette, levée à six heures, trouve Louis à la cave, à la recherche d'un peu de fraîcheur, l'air absent »
Les vieux chats se cachent pour mourir, et la plupart des bêtes d'ailleurs, qui ont gardé l'instinct ; venues seules au monde, elles partiront seules. Lui, savait ça, pas de spectacle, pas de visiteurs ! Rien à voir ! Rideau ; la farce est jouée ! et surtout, pas de médecin au chevet... Qu'on en finisse aurait-il dit... une fois pour toutes !
Les animaux qui peuplent l'arche veuve de son nautonier se sont tus, fidèles entre tous : « Il n'y a plus un aboiement, les chats sont invisibles, cachés, il n'y a plus un pépiement d'oiseaux. Toto le perroquet ne parle plus... Il va rester des mois sans parler... »
Après l'avoir veillé, les fidèles et amis de toujours l'accompagnèrent au cimetière des Longs Réages de Meudon où, désormais, il repose. Un voilier est gravé sur la pierre tombale lestée de petits cailloux anonymes, qui sont autant de pommes d'or au jardin des Hespérides. Louis Ferdinand Destouches, dit Céline, est entré dans l'Histoire de la littérature par la grande porte, n'en déplaise à ses détracteurs ; beaucoup n'y rentreront que par les coulisses et la plupart, n'y laisseront aucunes traces.
Le 5 juillet 1961, Kléber HAEDENS rendait hommage à l'écrivain dans un article reproduit dans le présent bulletin : « Ce qui maintenant commence ». Il s'indignait déjà de l'ostracisme dont l'auteur du Voyage faisait déjà l'objet de la part des pouvoirs publics : « On a voulu faire taire Céline et tout récemment encore, une émission préparée par la Télévision française a été interdite à la suite d'on ne sait trop quelles protestations médiocres. Mais voici qui est admirable. Toutes les puissances du jour se liguent contre l'homme seul qui se tient encore debout, un peu par miracle, le dos au mur de sa maison, entre sa femme, ses paperasses, ses clochards et ses chiens. » Et il concluait par cet éloge que n'aurait pas désavoué le philosophe de Sils Maria : « Le docteur Destouches a donc terminé son voyage au bout de son étrange nuit. Pour Céline et pour son œuvre, ce qui maintenant commence porte un très beau nom, disait Giraudoux, cela s'appelle l'aurore, une de ces aurores qui s'ouvrent désormais pour l'éternité. »
François MARCHETTI nous propose un ultime témoignage de Bente Karild qui avait connu Céline au Danemark ; elle y fait part de la sollicitude de l'écrivain envers elle, dès le moment où il avait perçu son chagrin et son angoisse à la suite d'une cruelle douleur affective. On regrettera que Bente Karild, n'ait pas conservé, à l'instar de nombreux autres correspondants, les lettres que lui avait adressées l'écrivain.
Enfin, c'est avec plaisir que nous découvrons dans ce même bulletin la contribution de Claude Duneton, l'auteur de Bal à Korsör, paru chez Grasset en 1994, à travers une note portant sur Céline et la langue populaire : « Céline n'a pas inventé la langue populaire, c'est plutôt le langage populaire qui l'a inventé lui... ». Sans doute pourrait-on dire la même chose de Bruant. Céline, nourri des classiques, a compris l'usage qu'il pouvait faire de la langue populaire et le parti qu'il pouvait en tirer : ourdir un texte en trois dimensions. Dans cette perspective, reconnaissons qu'il y a dans l'œuvre célinienne, plus d'un point commun avec celle de Praxitèle : il suffit d'être en leur présence pour les reconnaître.
20:17 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : céline, mort, meudon, maïtou, ruelle aux boeufs



