08/05/2011
AU TAUREAU DANS L'ARENE

Photographie Lucien Clergue
« A l’âge de huit ans, j’ai vu un type taquiner un tigre avec une barre de fer ; le tigre râlait terriblement. En m’éloignant, étourdi d’impuissance et fou de rage, j’ai murmuré : “ attends seulement, mon petit ange, tu verras, le jour viendra où je te jetterai ce salaud en pâture !“ Et je n’ai jamais douté que ce jour ne doive effectivement arriver – et je n’en doute point.» (Ladislav Klima : Ma confession philosophique.)
« La vraie compassion pour les animaux se reconnaît au fait qu’elle passe aux yeux de l’humanité en totalité pour le comble de l’exagération, du ridicule, de la folie, de la perversité (…) L’amour pour les animaux est chose bien plus tardive, plus subtile, plus sublime que celui que l’on voue aux humains ; celui-ci tire son origine du minable sentiment égoïste de solidarité ; celui-là est objectif, supra-égoïste, purement « éthique ». Evidemment, rien ne l’empêche de s’apparenter à un amour semblablement supra-égoïste et purement éthique pour les humains. Mais les deux ne pourraient se présenter simultanément et dans toute leur plénitude que dans l’âme d’êtres supra-animaux ; cette symbiose n’a été que partiellement réalisée par les héros de l’amour – Bouddha, Franciscus Seraphicus, Brezina… » (Ladislav Klima : Traités et Diktats.)
Il me faut à présent parler des taureaux.
Pourquoi ? Parce qu’à l’heure où un président aficionado et son ministre de la culture s’arrogent le droit de classer « patrimoine culturel immatériel national » la tauromachie, il me vient aux naseaux du taureau astral que je suis des envies de bouter dans l’arène ces tristes sires, à grands coups de cornes dans le train, histoire de leur faire goûter aux supplices raffinés infligés au roi des prairies. Parce qu’il faut le dire et le répéter, la tauromachie est odieuse tout autant que le sont les abattoirs. Elle l’est même davantage, puisqu’elle se réclame d’une « tradition culturelle » et d’un « art » qui, à le regarder de près, s’apparente assez bien à celui qu’un charcutier hystérique se prenant pour un maître de ballets déploierait à seule fin d’arranger ses viandes. Je crois, il me semble, que c’est à Giscard –grand carnassier devant l’Eternel- qu’on doit l’introduction des corridas avec mise à mort en France. La corrida n’a rien de national (du moins pas celle-là ! la pagaille politique oui !) ; la classer comme telle n’a par conséquent aucun sens. Le spectacle qu’elle offre est d’autant plus affligeant et révoltant, qu’elle accommode cette boucherie à la sauce festive.
Sous les flons-flons, au son des trompettes et des cris déchaînés d’une foule hystérique, torse bombé constellé de passementeries, et cul serré dans le satin, le bourreau, fier comme Artaban, entre en scène « en su traje de luz »…
Qu’on imagine deux secondes cet orgueilleux pantin dans un monde inversé où le taureau tiendrait le rôle du matador, comment qu’ il se mettrait à genoux, le charognard bipède, pour demander grâce ! Il n’est pas sûr d’ailleurs que le taureau daignerait seulement le considérer.
Pour se livrer à l’abattage rituel d’une victime innocente qu’on aura au préalable préparée de manière cruelle de façon à ne lui laisser guère de chance, il n’est point nécessaire d’avoir acquis ses lettres de noblesse sous la mitraille d’un champ de bataille !
Quelle gloire y a-t-il de s’attaquer à un taureau innocent sinon celle de prouver « qu’on a des couilles » et de faire se pâmer les belles ? Et l’animal, quelle chance a-t-il d’encorner le moustique agressif ?
Le taureau ne vient pas se balader comme ça, frai et dispo pour un petit tour de piste dans l’arène, à seule fin de recevoir tout au plus quelques égratignures avant que d’être expédié, ainsi dire en douceur, au paradis de ses congénères ! On l’y pousse et on l’y jette ainsi que Daniel dans la fosse aux lions, arrangé salement aux petits oignons par des sadiques qu’on aurait plaisir à jeter en pâture aux requins. Songer qu’en coulisse, entre autres raffinements, après l’avoir tenu quelque temps dans le noir absolu, on le « travaille » en lui bourrant les naseaux de coton hydrophile qu’on pousse aussi loin qu’on peut ; on lui met de la vaseline ou des liquides vésicants dans les yeux ; on le tabasse à coup de sac de sable ou de planche sur l’échine ; on lui entaille les cornes ; on lui enfonce des aiguilles dans les testicules…
Toutes les associations qui ont enquêté sur ce sujet, dont la Ligue antivivisectionniste de France qui s’occupe de la défense des animaux martyrs, expliquent que c’est à l’assassinat d’une bête moribonde qu’on se livre dans l’arène, une bête épuisée par les hémorragies internes et externes provoquées par la pique du picador et les banderilles.
Ce genre de divertissement qui le dispute aux abattages rituels des chaînes casher ou hallal donne une idée où nous en sommes rendus après des siècles de « civilisation » ! On voit par là combien l’homme est devenu sage ! On pourrait croire, si on était naïf, qu’il a changé depuis les cavernes ! Ah ! mais pas du tout ; il a gardé le goût du sang cet histrion et l’a poussé si fort, en raffinements qu’on n’imagine pas, qu’il en redemande à volonté. Qu’on réveille les combats de gladiateurs comme disait Céline, y aura du monde ! Et quelle différence y a-t-il, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, entre la corrida et un « snuff-movie » ? Les salopards, dans les deux cas, font le même boulot. Je vois pas de différence entre ces voraces et ceux qui les encouragent.
Et pourtant, il existe des repentis. Je me souviens de la confession d’un matador, entendue un jour à la radio. Cet homme après avoir expédié son comptant de taureau, soudainement et, en quelque sorte touché par la Grâce, s’était jeté -comme Nietzsche au cou du cheval- aux pieds du taureau agonisant, son dernier taureau, en lui demandant pardon et en l’embrassant. Parce qu’il avait lu dans le regard suppliant de cet animal qui mourrait à douleur la question qu’il lui posait : « Que t’ai-je fait ? ». Ainsi avait-il mesuré par-là sa propre condition et sa détresse. Jamais plus cet homme n’était redescendu dans l’arène…
Je suis pas le seul à me révolter sur le sujet, que non ! Parcourez le net, signez les pétitions, osez regarder en face les terribles photos que montrent les sites spécialisés… Et songez deux secondes qu’il se trouve à l’heure où je vous cause, en France, des petits trous de culs qui s’amusent au « torero » en esquintant des veaux, dans des écoles spécialisées, sous le regard complaisant de leurs salauds de géniteurs… Il se trouve aussi quelques femmes, hélas…
Languedoc, terre des troubadours et de la Chevalerie Amoureuse, quel besoin as-tu d’arroser ta terre du sang des taureaux ? Celui des Cathares, encore frais, te suffit-il pas ?
Je n’écrirai pas au ministre ni au président pour demander la grâce des taureaux, assuré qu’ils n’en on rien à foutre ; je leur souhaite simplement au jour du jugement, comme je le souhaite à tous les tortionnaires et autres aficionados, de s’éveiller dans le noir d’un toril devant que de se voir jeter sans ménagement au mitant d’une arène sanglante, sous les applaudissements de la gent bovine… Juste retour des choses…
« Il y a toujours pour moi cet aspect bouleversant de l’animal qui ne possède rien, sauf la vie, que si souvent nous lui prenons. » (Marguerite Yourcenar : Souvenirs pieux.)
« Le véritable test moral de l’humanité (le plus radical, qui se situe à un niveau si profond qu’il échappe à notre regard) ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci : les animaux. Et c’est ici que s’est produite la faillite fondamentale de l’homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent. » (Milan Kundera : L’Insoutenable légèreté de l’être.)

Pour faire part de votre désapprobation au gouvernement, je vous invite à signer la pétition ICI.
Les sites à consulter: CRAC Europe, Blog de Boules de poils, Blog de SOS animaux, Blog de souffrance. Video anti-corridas.
On lira, sur certains de ces liens, l'indignation de quelques jeunes internautes révoltés par la façon dont sont traités les animaux sur cette terre; ils le disent avec leur coeur. C'est une note d'espoir dans ce monde de brutes...
13:25 Publié dans Chroniques du temps présent | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : taureau, arènes, klima, yourcenar, kundera, compassion, bouddha, ethique, ministre, giscard, artaban, matador, daniel, toril, sang, cathares
27/06/2010
LIEUX DU CRIME

L’assassin est un peintre au couteau qui dispose les objets de son crime comme l’artiste le fait d’une nature morte sur sa toile. Tout est arrangé à dessein de façon à « séduire » c’est-à-dire à impressionner le spectateur.
Le procédé est toujours le même : le peintre, ou le meurtrier professionnel, sélectionne ce qui en premier frappera l’observateur ; il calcule, analyse et s’applique à l’ouvrage du mieux qu’il peut. La pratique aidant, il le fait machinalement. Ayant en quelque sorte obtenu son brevet de maîtrise, il s’attache à transmettre son art ou à garder jalousement le secret de ses compositions. Le meurtrier occasionnel, lui, emporté par ses humeurs, n’obéissant qu’à l’aveuglement de sa passion, reste un amateur et gâche la toile.
On ne saura jamais quels soins apporta Chardin à ses natures mortes, mais ce que remarquèrent les artistes qui traitèrent de semblables sujets, c’est que toujours, « quelque chose » dépassait du bord du support de la composition : une feuille de vigne, un poireau, la patte d’un lièvre ou la pince d’un homard, mais plus généralement, le manche d’un couteau…

Le procédé ne date pas d’hier, mais sans doute de l’invention de la perspective ; les maîtres flamands en ont usé dès l’instant où ils ont compris quel avantage il accordait à la lecture de l’oeuvre en soulignant la profondeur de champs et la valeur du plan de la scène.
« Mon grand-père m’attendait dans son fauteuil de velours d’Utrecht. Je m’asseyais du côté de sa bonne oreille, car, depuis l’enfance, il était sourd de l’oreille droite, et, sous mes questions, sa langue n’était pas longue à se délier. Je réclamais le plus souvent, tant l’attrait m’en semblait inépuisable, l’histoire de l’Assassinat du petit garçon.
Il s’agissait d’un enfant de cinq ans qu’à l’époque des vacances de 1845, ses parents avaient abandonné dans leur maison de campagne sise à dix kilomètres d’Aubusson, à la garde d’une vieille femme de confiance. Tous les deux –le petit maître et la gouvernante- occupaient le même lit. Par une nuit d’étoiles, quelqu’un était venu, avait défoncé la fenêtre et, bondissant dans la pièce, un marteau de maçon à la main, s’était livré à une effroyable tuerie…
Le soir, quand je me retrouvais dans mon petit lit et que mes parents, après avoir emporté la lumière, me laissaient à mon sommeil ou à mes pensées, je frissonnais de tous mes membres. Le vent sous le rideau de la cheminée, un craquement dans les boiseries, un bruit de pas, le grincement d’une girouette, il n’en fallait pas davantage pour que mon cœur battit à coups précipités. Mais si je parvenais quelquefois à commander à mes angoisses, que devenais-je, grand Dieu ! quand le rêve m’emportait au pays de l’épouvante ? Brusquement, je me trouvais seul dans la maison du crime, en pleine nuit et loin de tout secours. Et, pendant que, les pieds cloués au sol, je cherchais en vain à crier ou à m’enfuir, l’assassin s’avançait vers moi en levant son marteau… »
Ainsi s’exprime Pierre Bouchardon dans ses « Souvenirs » qui furent édités en 1953.
Les œuvres de cet ancien magistrat, né à Guéret le 9 avril 1870, connurent un succès populaire par le fait qu’elles rapportaient, non seulement les procès des grandes affaires criminelles du temps, mais aussi des meurtres plus anciens inscrits au registre des classiques en la matière.
La plupart de ces récits, publiés par Albin Michel, sont encore assez faciles à trouver chez les bouquinistes ou sur le net, avec un peu de patience.
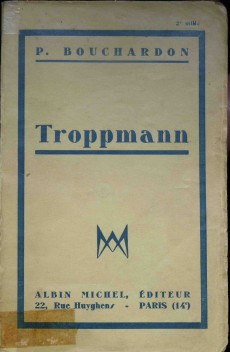
J’ai découvert cet auteur en achetant son « Troppmann » à un bouquiniste du Quai de la Mégisserie en 1970. J’ignorais tout de ce crime à faire « dresser les cheveux sur la tête ». Il eut lieu en 1869 en bordure du chemin Vert, dans la plaine de Pantin… Bouchardon le relate tel quel, dans toute son horreur. Ce magistrat, qui fut successivement juge, procureur de la République, chef du bureau des Affaires criminelles au Ministère de la Justice, président de la Cour d’appel de Paris et conseiller à la Cour de cassation, n’y va pas par quatre chemins et son art de narrateur, tout empreint de la faconde des tribunaux, nous transporte comme si nous assistions au procès, dans la salle d’audience…
Il nous emmène de la même manière sur les lieux du crime et nous fait partager, les yeux grand ouverts, ce que découvrirent les premiers témoins.
Sans doute l’ assassinat du petit garçon eut-il sa part dans la vocation de Pierre Bouchardon ; il le confesse d’ailleurs lui-même dans ses « Souvenirs » : « L’affaire m’obséda à ce point qu’elle ne fut pas étrangère, je le peux croire, à ma décision d’entrer dans la magistrature. » Et, comme il était doué pour écrire, il mit ses dons de narrateur au service de sa plume et nous laissa plus de trente récits, plus terribles les uns que les autres, dont on trouvera la liste en fin de note.
Tels nous surprendront à les relire « Le Crime de Vouziers », « L’Enfant de la Villette », « Le Puits du Presbytère d’Entrammes » ou « L’Affaire Pranzini ». Quant à l’auberge de Peyrebeille, dite « l’Auberge Rouge », sise sur la grand route du Puy à Aubenas, sans doute ne saura-t-on jamais exactement ce qu’il en fut, même si l’on se plaît à montrer au visiteur le four, la « poutre tragique », les chambres maudites… Ce qui est sûr c’est que tombèrent au milieu de la cour sous le couperet les deux têtes des époux Martin et celle de leur domestique Rochette. Une pierre dressée en marque l’emplacement exact.
Je n’ai point, pour ma part, embrassé la carrière de magistrat bien que j’ai été frappé et au même âge, tout autant qu’a pu l’être Pierre Bouchardon, par le récit que me fit ma grand-mère d’un crime abominable ayant eu lieu non loin de la propriété que nous occupions alors à Limoges, dans le quartier du quai Militaire. Souvent, je passais près de la maison du drame, aujourd’hui disparue… Elle occupait, au débouché du tunnel du chemin de fer au lieu dit le Puy-Imbert, l’angle d’une rue ; une grande maison carrée en face d’un lavoir, avec un jardin attenant livré aux broussailles… Et toutes les fois je me disais : « C’est là ! ».
Oui, c’était là qu’un jour de 1889, dans la nuit du 9 au 10 avril, une pauvresse, la femme Souhin, chiffonnière de son état, avait étranglé ses quatre petits dont les âges s’échelonnaient entre onze ans pour l’aîné des garçons et quelque mois pour la dernière-née. Ce que trouva à dire la criminelle qui ne pu, en dépit de ses tentatives parvenir à mettre un terme à ses jours, c’est qu’elle avait été contrainte de tuer ses enfants ne pouvant les nourrir, poussée à l’extrême pauvreté accrue par l’arrestation de son mari, auteur de quelque larcin. C’était un crime de la misère qu’avaient caché ces murs gris et austères ; fallait-il ajouter à l’horreur de ce quintuple infanticide le fait que leur mère, après avoir étranglé ses enfants, les ait jetés dans le puits de la cour ? C’est néanmoins ce que colporta la rumeur et c’est ainsi que me fut contée l’histoire…
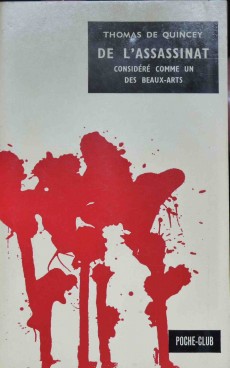
Plus tard j’en appris une autre, sanglante celle-ci, et aussi brutale que les meurtres de John Williams rapportés par Thomas de Quincey dans son essai « De l’assassinat considéré comme un des Beaux-Arts ». Le ou les tueurs n’avaient jamais été retrouvés qui avaient égorgé au rasoir dans une rare violence, un soir d’octobre de l’année 1960, les aubergistes du Café du Terminus, en face de la gare des Charentes. Le café a été démoli depuis; on l’a remplacé par un terre-plein arboré dont l’emprise au sol rappelle exactement l’emplacement du bistrot… On trouve ce récit dans la collection « Les Grandes Affaires Criminelles », publiées par les Editions de Borée, dans le volume (T.2) concernant le département de la Haute-Vienne.
Enfin un crime abominable, celui-ci accompli par un attroupement de paysans, m’a longtemps frappé qui fut commis sur la personne de Monsieur de Moneys, dans le village de Hautefaye, en Périgord, dans le Nontronnais, le 16 août 1870. J’avais découvert étant jeune, dans la maison de campagne de mon arrière grand mère, les coupures de journaux qu’elle avait conservées du « Courrier du Centre », où cette affaire avait été relatée en feuilleton. Illustrées de gravures montrant les têtes patibulaires des tueurs, le « crochet » de chiffonnier de l’un d’eux, les masures où on avait traîné le corps ensanglanté de la victime et la mare asséchée dans laquelle on l’avait fait brûler respirant encore, ces illustrations avaient de quoi frapper l’imagination !
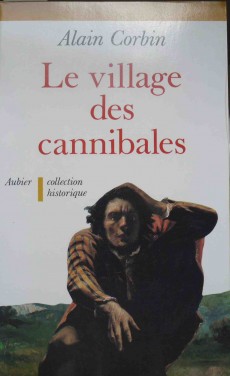
Je ne suis jamais allé à Hautefaye, encore que le plan soit connu du « trajet » de la victime. Les lieux ne doivent pas avoir beaucoup changés. On lira cette affaire dans l’ouvrage remarquable d’Alain Corbin paru chez Aubier.
Les crimes de sang sont de loin les plus effrayants. Qui habiterait une maison où il a éclaboussé les murs et parfois jusqu’au plafond ? Qui habiterait le château d’Escoire ou certaine maison de Thorigné sur Due qui fit parler d’elle dans les conditions que l’on sait, il n'y à guère ?
Les lieux du crime ? A bien y réfléchir, et depuis que le monde est monde, il ne doit pas y avoir beaucoup d’endroits sur terre ou quelque meurtre n’ait été commis, en tout cas pour les villes et les campagnes habitées, pour ne pas dire « hallucinées » comme les voyait le poète Emile Verhaeren. Je me suis souvent fait cette remarque en me promenant dans Paris, le Paris historique qui connut les heures sombres de la Terreur ou, pour un oui pour un non, on vous trucidait allègrement au coin d’une rue ou dans l’ombre d’une porte cochère. Quant aux exécutions capitales, au temps où la guillotine fonctionnait sans interruption sur la place de la Révolution dite depuis « de la Concorde », qui saura nous dire combien de litres de sang ont saturé le pavé sous l’échafaud ?
Place du Bouffay, à Nantes, je songeais certain jour à la décapitation des demoiselles Vaz de Melo de la Métairie dont la plus jeune, Olympe, n’avait que quinze ans… C’était le jour même où, place Viarmes, à l’endroit précis marqué au sol par des pavés en croix, me revinrent en mémoire les mots lancés par Charette, fusillé là par la République en 1796: « Et pourtant, nous sommes la jeunesse du Monde ! »

Jeanne à Rouen, Charette à Nantes, Ney près de l’Observatoire à Paris, le Duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes, Giordano Bruno à Rome… combien d’autres ? La liste serait longue à dresser des crimes officiels, commis par des assassins bien souvent anonymes portant la robe, la chasuble, la tunique ou l’uniforme ! A peser ce qui dort en chacun de nous de Fouquier-Tinville ou de Torquemada, on se dit qu’il suffirait d’un rien pour expédier de l’autre côté l’adversaire, si l’on n’y prenait garde !
Aussi faut-il, sur les lieux du crime, se poser la question : « Cela a été et cela n’est plus… » en sachant qu’il ne s’agit pas d’un rêve, quelque impensable qu’ait pu être l’événement dont il a été le théâtre. Il semble que le sang soit là, encore tout frais, comme sur la clef du conte de Barbe-Bleue pour nous le rappeler ! Et des lieux terribles s’y prêtent, comme le terrain vague du « Dahlia Noir », les friches industrielles, les anciens abattoirs, les hangars abandonnés, les décharges publiques, qu’affectionnent les assassins soucieux de la discrétion ou de la mise en scène.

Qu’est-ce qui nous pousse, un jour ou l’autre, à aller voir de près le théâtre d’un drame, et bien souvent des années après qu’il ait eu lieu, sinon le besoin impérieux de « l’exorciser » ? de « communier secrètement » avec la victime ? D’imaginer deux secondes, deux secondes seulement qu’on ait été à sa place… Oui, à sa place ou peut-être à celle de l’assassin ?

Les crimes, aussi épouvantables soient-ils, relatés à la une des quotidiens ou des journaux spécialisés ( « Radar » de nos grands parents, ou « Détective »), ont toujours alimenté la littérature populaire et fait recette au Grand Guignol. Et pourquoi ? mais parce qu’ils « plaisent », en dépit de leur horreur même, par le pouvoir qu’ils ont de réveiller en chacun de nous, la peur du « Grand Méchant Loup » des contes de la veillée, la « fascination » devant le tigre.

Ainsi « aime »-t-on avoir peur, quelque envie qu’on en ait ; et sans doute parce que la peur est sage conseillère , mieux vaut ne pas la montrer ! C’est souvent la condition de la survie. Cela s’apprend et cela s’enseigne, au plan personnel comme au plan collectif. Les assassins de tout temps et de tous crins le savent bien, qui comptent sur elle pour alimenter leur palmarès. A y regarder de près c’est ce qui se passe : un chien vous mord quand il sent que vous avez peur. Et peut-être aussi parce qu’il a peur lui-même ?
Qui a dit : « Si les hommes sont si méchants, c’est parce qu’ils ont peur… » ?
Où en sommes-nous, aujourd’hui ?

Œuvres de Pierre BOUCHARDON :
Le mystère du château de Chamblas, (Albin Michel 1922)
Le crime de Vouziers, (Librairie Académique Perrin 1923)
L’auberge de Peyrebeille, (Albin Michel 1924)
L’affaire Lafarge, (Albin Michel 1924)
La tragique histoire de l’instituteur Lesnier, (Librairie Académique Perrin 1925)
Le crime du château de Bitremont, (Albin Michel 1925)
La fin tragique du Maréchal Ney, (Hachette 1925)
L’énigme du cimetière Saint Aubin, (Albin Michel 1926)
Le Magistrat, (Hachette 1926)
Le duel du chemin de la Favorite, (Albin Michel 1927)
La tuerie du pont d’Andert, (Librairie Académique Perrin 1928)
Les dames de Jeufosse, (Albin Michel 1928)
Célestine Doudet, institutrice, (Albin Michel 1928)
L’auberge de la Tête Noire, (Librairie Académique Perrin 1928)
Les procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1928)
Le Docteur Couty de la Pommeraie, (Albin Michel 1929)
Le banquier de Pontoise, (Edition des Portiques 1929)
L’enfant de la Villette, (Nouvelle Revue Critique 1930)
Autres procès burlesques, (Librairie Académique Perrin 1930)
Le cocher de Monsieur Armand, (Edition des Portiques 1930)
Ravachol et Cie, (Hachette 1931)
L’Abbé Delacollonge, (Librairie Alphonse Lemerre 1931)
Troppmann, (Albin Michel 1932)
L’homme aux oreilles percées, (Nouvelle Revue Critique 1932)
La faute de l’Abbé Auriol, (Nouvelle Revue Critique 1933)
La malle mystérieuse, (Albin Michel 1933)
L’affaire Pranzini, (Albin Michel 1934)
Un précurseur de Landru, l’horloger Pel, (Arthaud 1934)
L’assassin X, (Albin Michel 1935)
La dernière guillotinée, (Nouvelle Revue Critique 1935)
Dumollard, le tueur de bonnes, (Albin Michel 1936)
Hélène Jégado, l’empoisonneuse bretonne, (Albin Michel 1937)
Vacher, l’éventreur, (Albin Michel 1939)
Le puits du presbytère d’Entrammes, (Albin Michel 1942)
Madame de Vaucrose, (Albin Michel 1947)
Souvenirs, (Albin Michel 1953)
Orientations :
Editions de BOREE : Collection « Les Grandes Affaires Criminelles ».
Alain CORBIN : Le village des cannibales, Aubier collection historique, 1990.
James ELLROY : Tous les ouvrages parus aux éditions Payot, collection Rivages Noir, et particulièrement « Ma part d’ombre », « Le Dahlia Noir » et « Un tueur sur la route ».
Emile GABORY : Les guerres de Vendée, Laffont, collection Bouquins.
Thomas de QUINCEY : De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts, Poche-Club, Nouvel Office d’Edition 1963.
Charles RIVET : Mémoire noire, Editions René Dessagne.
17:00 Publié dans notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : crimes, meurtres, assassinat, bouchardon, troppmann, sang, hautefaye, peyrebeille, guillotine
14/03/2010
14 MARS 1909

André PIEYRE de MANDIARGUES, né le 14 mars 1909 à Paris, a laissé une œuvre littéraire importante s'inscrivant dans le courant surréaliste auquel il appartint. Ce passionné d'érotisme et de fantastique, qui a touché à tous les genres littéraires ( Poésie, romans, contes, nouvelles, essais, théâtre ), obtint le prix Goncourt 1967 pour son roman La Marge qui connut, sous le même titre, une adaptation cinématographique en 1976.
En 1946, l'auteur fit paraître Le MUSEE NOIR, édité par Laffont ; un recueil de nouvelles dont la première intitulée « Le sang de l'agneau », dédiée à Leonor Fini, résume à elle seule l'univers de Mandiargues contenu tout entier dans la première phrase :
« Marceline Caïn : on eût dit qu'elle était mêlée de cendre, de sable et de sang. »
C'est une histoire, comme il la conclut lui-même, « qui fait frissonner au milieu de la nuit : une histoire de fourrure et de sang. »
Mais c'est dans l'Introduction au Musée noir qu'il faut aller chercher la fascination qu'exerce aux yeux du poète le tellurisme élémentaire et les forces vives de la nature qui renferment bien plus que leur propre substance :
« Le panorama dressé par les sens dans la conscience de l'homme est un écran peu solide ; percé à chaque instant de trous, secoué par les tourbillons, il n'aveugle que ceux qui cherchent précisément à ne rien voir au-delà de son médiocre ready-made. Quelquefois les trous se rejoignent sur le bris des derniers fils du tissu dans une totale discontinuité des images, ou bien les tourbillons renversent entièrement le pauvre appareil, c'est alors l'heure de la voyance, c'est aussi l'heure de l'idiotie, les deux visages absolus de ce que l'on a parfois nommé le mysticisme, mais il est rare, le désirât- on, d'arriver à ces excès, et le plus souvent la mécanique continue à promener au dessus des gouffres aperçus, dans un grincement rassurant de vieillerie, des tableaux dont la laideur et l'horreur même à laquelle ils atteignent de temps en temps sont rendus acceptables par le respect des lois de causalité et le conformisme banal avec lesquels ils se présentent.
Les plus hautes falaises de l'Europe, dit-on, dressent à Berneval, et dessous c'est une grève tourmentée de grands éboulis chaotiques, leurs parois d'une matière douce au toucher quand une cassure vient d'en rafraîchir la surface, mais que l'action du vent et celle de l'humidité saline ont vite revêtue d'une croûte rugueuse allant, entre des bandes de taches bleu sombre, du blanc au gris, au vert sale et à un beige un peu trouble qui est la marque de traînées terreuses descendues du sommet aux jours de tempête. Rien que de la marne avec des noyaux de silex qui deviendront, les uns sur les autres roulés par les vagues, ces galets, en bas, comme une ponte aplatie que l'on voudrait attribuer à des foisons de tortues. Pourtant il demeure dans ces pâles murailles colossalement offertes à l'orgasme de l'écroulement, couronnées de cris d'oiseaux, et qui dominent un fouillis de filets peureusement mis à sécher sur des perches avec des blondeurs tremblantes de crin au soleil, une vie si tendre, de chairs déformées par le titanisme, que ne pourrait l'évoquer aucune parole humaine, sauf, peut-être, le nom d'Astyanax prononcé sous une petite pluie de printemps à l'oreille d'une jeune fille dont on serre les doigts au fond de son manchon de grèbe.
Voilà pour suggérer un seul des dessous de la craie, car il en existe une multitude d'autres. Et toutes ces matières simples ou composées, mais pour l'homme rétif à la connaissance apprise aussi élémentaire que des corps purs : le charbon, le sable, la suie, le plâtre, la glace, la neige, la laine, l'or, le fer, le plomb, le bois, la mousse, le sang, le pain, le lait et le vin, dès qu'elles interviennent dans la sensation, quelles portes n'ouvrent-elles pas sur des coulisses vertigineuses ? Ainsi, la crainte qui entoure le sang répandu par l'hymen lacéré, on aperçoit sans peine qu'elle se rapporte plutôt au meurtre du père et de la mère abolis en même temps du souvenir de la jeune fille dans la rupture violente des disciplines familiales ; meurtre qui pourrait, sur un arrière plan de boucherie, prendre forme un jour avec une terrible précision.
Des lieux et certaines heures unissent, affrontent ou fortifient les auréoles (ou zones d'illumination) propres aux diverses matières. Par ces chocs, par ces combinaisons d'auréoles, naît ce que l'on a communément entendu sous le nom d'atmosphère : un climat propice à la transfiguration des phénomènes sensibles. Allez en forêt saisir le midi frémissant des clairières ; découvrez le minuit des carrières à l'abandon, des plages retirées où s'enjolivent de lune les menues alluvions déposées par le flot ; explorez les gares, les passages, les souterrains des grandes villes, les maisons closes comme des confitures de velours en pots de miroir, les salles de jeu, les foires à la brocante, les théâtres vieillis ; parcourez les gorges des torrents polies et dures telles que des chevaux cabrés, les grottes, les chemins de planches jetés aux marécages ; tant de choses qu'à moins de les voir en aveugle on doit regarder jusqu'à se brûler ou se crever les yeux, et tous les ricanements des bonshommes, toutes les ordonnances de leurs clergés ou de leurs polices, ne pourront plus rien contre l'innocence farouche d'un univers enfin déchaîné... "
17:45 Publié dans Portraits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pieyre de mandiargues, musée noir, craie, sang, conscience



