05/12/2009
PARTAGE DE LA PITIE
J'ai vu hier au soir en rentrant, comme dans un tableau, un tableau de la cruauté, une vache et un pommier dans un mauvais cadre, celui de la fin d'une zone industrielle sous une pluie battante. Je venais de me faire doubler par un gros 4x4 rempli d'une famille de polygéniteurs. Le pommier était aux trois quarts arraché, penché à l'extrême sur un bourbier où achevaient de pourrir ses pommes ; la vache, une limousine efflanquée, était plantée en vis-à-vis, emplâtrée de fange au bord du bourbier, elle attendait. On avait coupé ses cornes, mal, à mi-longueur comme on le fait ordinairement, dans un siècle où l'on ne veut plus de cornes aux vaches, plus de bogues aux châtaigniers, plus d'épines aux rosiers. Derrière la scène, un mauvais pré remontait en pente raide en direction d'un lotissement... Cette bête me fixa quand, arrivé à sa hauteur je ralentis, et bizarrement, outre le fait que je pensais en la regardant aux abattoirs alimentés quotidiennement par ses congénères pour nourrir les carnassiers et les polygéniteurs, par association d'idées me vint à l'esprit l'étrange tableau d'Evariste-Vital Luminais : « Les Enervés de Jumièges »...

Cette toile emblématique est à Rouen, au Musée des Beaux-Arts ; elle résume pour moi la condition humaine et par extension celle du vivant tout entier. On y voit deux hommes allongés dans un bac à la dérive sur la seine ; ils sont adossés à des coussins et recouverts d'un tapis qui tombe dans l'eau... L'un d'eux laisse pendre un bras comme s'il allait plonger ou venait de retirer sa main du fleuve, on ne sait pas ; l'autre a les mains ramenées sur son ventre, au-dessus du drap qu'on dirait qu'il retient. Les pieds et une partie des jambes du premier sortent de dessous le tapis ; ils sont enveloppés de bandelettes comme ceux d'une momie. Ces deux suppliciés ont été « énervés » : on leur a, selon la coutume du temps appliquée à la trahison, scié les jarrets pour en arracher les nerfs... La scène paraît figée et l'eau morte, les regards, fixes, paraissent figés eux aussi, pour l'éternité. Devant une telle toile, « même l'horreur tourne aux enchantements », sans doute parce que l'horreur est suggérée plus qu'elle n'est montrée. Le tableau, présenté au salon de 1880, est mal reçu et tourné en dérision par la critique du temps, néanmoins il trouve des défenseurs qui n'ont pas été sans saisir en le détaillant toute la force émotionnelle et l'inquiétude contenue qui s'en dégage. Et c'est vrai qu'on se sent suspendu en permanence entre deux choix en sa présence : celui de la vie et de la mort, de la révolte et de l'abandon, de la colère et de la paix. Et d'ailleurs, le bac s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il ? Torture ou béatitude ?
Il existe deux versions du tableau ; il est probable que celle de Rouen soit l'œuvre d'atelier et la toile exposée à Sydney la version du salon. Quoi qu'il en soit, elles ne diffèrent que dans les couleurs, les visages des personnages et le luminaire-reliquaire placé au pied de l'esquif. C'est suffisant toutefois pour leur donner deux dimensions équivoques : celle de Sydney est demeurée du côté des ténèbres, celle de Rouen aborde la lumière. C'est qu'il revêt plus d'importance qu'il n'y paraît, ce « pompier » luminaire entouré de roses, et à bien observer la flamme de la bougie, on voit que le vent (le souffle) vient de la terre plutôt que du fleuve : sont-il arrivés à bon port ?
On sent combien cette œuvre, qui tire son origine d'une légende des temps mérovingiens, celle des fils de Clovis II châtiés pour trahison, est emblématique en ce qu'elle résume la puissance du destin et devant elle, comment ne pas songer à ses vers de Lamartine :
« Ainsi tout change, ainsi tout passe ;
Ainsi nous-mêmes nous passons,
Hélas ! sans laisser plus de traces
Que cette barque où nous glissons
Sur cette mer où tout s'efface. »
Revenons à cette vache puisque c'est parti d'elle. Il m'a semblé qu'elle attendait là, devant ce trou rempli d'eau, depuis des mondes d'années, patiente. Et à la considérer, cette patience, j'ai mesuré combien elle semblait proche de celle des suppliciés de Luminais, des malades et des pauvres gens, de ceux qui n'ont rien d'autre à attendre de la vie que le secours de la grâce ; qu'elle confinait à la résignation en attente de la délivrance. Et je me suis dit que c'était peut-être ça après tout la condition humaine : l'apprentissage d'une longue patience avant la chute ou le lever du rideau, comme on voudra.
On consultera avec profit le petit livre de Dominique Bussillet : « Les Enervés de Jumièges », éditions 2007, Cahiers du Temps, Cabourg.
16:34 Publié dans Chroniques du temps présent | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : luminais, énervés, lamartine, jumièges
06/11/2009
PENSEE DES MORTS
J’ai toujours vu novembre comme le mois des lamentations : les jours s’étiolent, le brouillard tombe (brumaire), le froid s’installe (frimaire), les chrysanthèmes s’amoncellent dans les cimetières… la Mort cogne à la porte
C’est la saison où tout tombe
Aux coups redoublés des vents ;
Un vent qui vient de la tombe
Moissonne aussi les vivants ;
Ils tombent alors par mille,
Comme la plume inutile
Que l’aigle abandonne aux airs,
Lorsque des plumes nouvelles
Viennent réchauffer ses ailes
A l’approche des hivers.
…

Ah ! quand les vents de l’automne
Sifflent dans les rameaux morts,
Quand le brin d’herbe frissonne,
Quand le pin rend ses accords,
Quand la cloche des ténèbres,
Balance ses glas funèbres,
La nuit, à travers les bois,
A chaque vent qui s’élève,
A chaque flot sur la grève,
Je dis : « N’es-tu pas leur voix ? »
Alphonse de Lamartine, "Pensées des Morts", Harmonies Poétiques et Religieuses, 1830
La mort inspire, forcément, c’est même ce qui inspire le plus par l’avantage qu’elle a, sur les autres, d’être le plus grand des mystères. C’est pourquoi on ne saurait manquer l’occasion quand on l’a, de traverser l’enclos des morts, ne serait-ce que parce ce que l’œil attentif y trouvera toujours de quoi s’interroger sur sa condition qui n’est pas si éloignée de celle du veau qu’on mène aux abattoirs… A fouiller ce noir mystère on s’aperçoit assez vite que la seule issue possible consiste à tuer en nous l’idée même de la mort. En quoi le principe de Lavoisier peut nous aider :
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
Au Moyen Age existait un Ars Moriendi, diffusé à travers l’Europe à la faveur des grandes épidémies de peste. Partout la Mort, familière, entretenait avec les vivants des rapports de « sympathie » obligés et on lui rendait hommage dans les vitraux des cathédrales (Sainte marie de Lübeck), sur les fresques (Abbaye St Robert de la Chaise Dieu), sur les dalles des pierres tombales (Cathédrale de Courtrai). Les poètes chantaient sa toute puissance (Hélinand de Froidmont, Robert le Clerc d’Arras, Eustache Deschamps, François Villon) aussi bien que les artistes la représentaient à pied ou à cheval, infatigable moissonneuse (Albert Dürer, Hans Holbein, Lucas Cranach, Jacques Callot).
Et parce qu’on vivait dans sa confidence et que la dureté des temps portait à la considérer avec respect et à craindre son courroux, on rangeait soigneusement dans un trou du mur, le petit livre bleu du « Respit de la Mort » de Jehan Le Fèvre, ou d’autres textes similaires acheminés par le colporteur jusqu’au fond des campagnes…
L’idée de la mort a nourri le romantisme et inspiré les poètes de tous les temps et les écrivains. L’évoquer portait à s’entretenir avec elle, voire à l’implorer, ce que traduisent assez bien ces quelques vers du « Fléau » :
« Notre-Dame la Mort, toi qui te lèves,
Au battant de nos tambours,
Obéissante –et qui toujours-
Nous fut belle d’audace et de courage,
Notre-Dame la Mort, cesse ta rage,
Et daigne enfin nous voir et nous entendre
Puisqu’ils n’ont point appris, nos fils, à se défendre. »
Emile Verhaeren, "Le Fléau", Les Campagnes Hallucinées, 1893
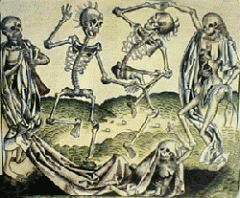
Jusqu’au XIXème siècle et naguère encore, existaient des pratiques, des rituels, des cérémonies et des gestes coutumiers que l’on faisait à l’égard des morts et que l’on ne fait plus guère aujourd’hui, dans nos sociétés « avancées ». Dans les sociétés dites traditionnelles, celles du moins qui subsistent encore -derniers vestiges de civilisations disparues- il en va autrement ; la règle s’est maintenue de considérer le défunt, non point comme un déchet, mais comme un membre à part entière du corps social, simplement parce que ce dernier à la différence de celui des sociétés marchandes, ne s’est pas tout à fait décomposé. Et c’est tellement vrai qu’on y honore toujours les défunts, qu’on les veille chez soi, dans leurs murs, dans le respect des trépassés, comme on le faisait hier encore…
On ne montre plus guère les morts de la famille aux enfants, on les cache… Le petit-fils n’embrasse plus la main crispée ou le front glacé du grand père passé de l’autre côté, mais il avale allégrement, ni plus ni moins qu’il le ferait d’une bande dessinée ou d’un jeu de rôle, les cruautés quotidiennes du petit écran : attentats, accidents, meurtres en tout genres et tortures raffinées…
Je me souviens du premier mort que j’ai vu quand j’étais petit, en l’occurrence c’était une morte, une voisine, l’épicière…
Dans sa chambre de l’étage au-dessus de l’épicerie où ses filles l’avaient disposée, elle reposait, le drap remonté sous le menton, ses deux mains potelées croisées sur sa poitrine. On lui avait arrangé ses cheveux en tresses qui lui faisaient comme une couronne sur la tête. Une couronne de sainte, c’est du moins ce que j’en ai retenu. Elle semblait dormir, paisible, dans la pénombre de la pièce qui sentait la naphtaline. C’était en juillet. Je m’en souviens à cause des mouches qui bourdonnaient dans la chaleur et aussi parce qu’on avait commenté ensemble le feu d’artifice depuis le fond du jardin, quelques jours avant qu’elle ne s’en aille.
Morte ou vivante je la trouvais pareille : gentille. On lui avait mis du coton dans le nez, allez savoir pourquoi ? En tout cas c’est la question que je m’étais posée… Quand elle me voyait rentrer chez elle, elle me donnait toujours une friandise, une de celles qui remplissaient jusqu’à la gueule les bocaux de verre alignés à côté du comptoir… Plus tard, quand j’ai découvert « Mort à Crédit », l’épicière, elle m’a fait penser à madame Bérenge… au chagrin…
« … Il est là dans l’odeur de la mort récente, l’incroyable aigre goût… Il vient d’éclore… Il est là… Il rôde… Il nous connaît, nous le connaissons à présent. Il ne s’en ira plus jamais. Il faut éteindre le feu dans la loge . A qui vais-je écrire ? Je n’ai plus personne. Plus un être pour recueillir doucement l’esprit gentil des morts…pour parler après ça plus doucement aux choses… courage pour soi tout seul ! »
Louis-Ferdinand Céline, "Mort à Crédit", 1936
Les morts ne sont pas tous dans les cimetières, il s’en faut, et depuis que le monde est monde le plus grand nombre gît sous les terreaux et l’on ne saura jamais qui ils furent ni ce qu’ils firent, tous les inconnus des grandes calamités et les anonymes moissonnés sur les champs de bataille. Quelle importance ? Ceux des cimetières témoignent pour eux :
« Prends garde à la douceur des choses,
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton cœur trop lourd… »



A l’heure où on se débarrasse des morts comme on se débarrasse des vieux qui passent directement de la maison de retraite ou de l’asile au funérarium et au crématorium ; à cette heure qui sonne le glas d’un certain art de vivre et de mourir, on chercherait vainement dans tout l’ attirail de bazar, le tape à l’oeil et la quincaillerie de prêt à porter funéraire, la beauté d’un simple tombeau… Partout l’expression de la vulgarité qui marque le siècle l’emporte et encourage les marbriers à n’extraire le granite ou le marbre des carrières que pour en tirer les horreurs qu’ on voit en l’espèce de caveaux. Et il se trouve de pauvres gens et des tocards pour encourager ce genre de négoce alors qu’on relègue à la décharge les vieilles concessions ! Admirez ces vieilles tombes, souvent faites d’une simple dalle gravée entourée ou non de sa grille à piques, d’une colonne portant sa croix, ou d'un fût tronqué sous des ifs, elles étaient rarement vulgaires.

Mais il en va aujourd’hui des cimetières ceinturés de plaques en ciment ou d’agglomérés de béton, comme de la banlieue, comme des coeurs de ville, comme des campagnes… comme de tout. Ca n’est pas nouveau, simplement ça ne s’est jamais exprimé avec autant de brio ni autant de hargne ; c’est ainsi le signe du temps…
Ca s’appelle la décadence puisqu’il faut l’appeler par son nom…
Quelle importance me direz-vous, si tout lasse, tout passe, tout casse ?

En ce mois des morts, méditons avec le poète John Gay (1685-1732), l’épitaphe qu’il fit graver sur sa tombe :
« La vie est une plaisanterie et tout concourt à le montrer. Cette idée m’est venue un jour ; mais à présent je le sais »
10:13 Publié dans Chroniques du temps présent | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mort, lamartine, ars moriendi, verhaeren, bérenge, cimetières, tombeaux



